
Note sur la transcription: Les erreurs clairement introduites par le typographe ont été corrigées. L'orthographe d'origine a été conservée et n'a pas été harmonisée. Les numéros des pages blanches n'ont pas été repris.
IL A ÉTÉ TIRÉ DE CE LIVRE:
15 exemplaires sur papier de Hollande.
10— sur papier de Chine.
Tous ces exemplaires sont numérotés & paraphés par l'Éditeur.

POÉSIES
DE
Daniel Lesueur
Visions Divines—Les Vrais Dieux
Visions Antiques—Sonnets Philosophiques—Sursum Corda!
Souvenirs—Paroles d'Amour

PARIS
ALPHONSE LEMERRE, ÉDITEUR
23-31, PASSAGE CHOISEUL, 23-31
M DCCC XCVI
VISIONS DIVINES

Que l'homme a tour à tour bénis et blasphémés.
Mes chants s'élèveront vers vos lointaines cimes
Pour tous les malheureux que vous avez charmés.
Vos bienfaisantes mains aux damnés de la vie,
A ceux qu'abandonnaient la Fortune et l'Amour,
Ont versé largement tous les biens qu'on envie,
Éternisant pour eux nos vains bonheurs d'un jour.
Ils ont vécu, le cœur bercé par leur chimère,
Traversant nos douleurs avec un front joyeux,
Et même ils ont souri lorsque la Mort amère
De son geste muet leur a fermé les yeux.
Ce qu'ils ont entrevu dans leur obscure voie
N'est pas le joug pesant d'un stérile labeur,
La terreur de la faim, la jeunesse sans joie,
Le trépas solitaire et sa morne stupeur.
Non: c'est un sûr chemin, plein d'épreuves mystiques,
Qui prend l'homme au berceau pour le conduire aux cieux,
Qu'on parcourt, enivré d'encens et de cantiques,
Versant du repentir les pleurs délicieux.
Saints transports effaçant toute douleur charnelle,
Inépuisable amour issu d'un cœur divin,
Impérissable espoir d'une extase éternelle,
Qui vous a possédés n'a pas souffert en vain.
Pour l'assouvissement des appétits sans trêve,
Malgré ses moissons d'or, le monde est trop étroit;
Mais aux déshérités s'ouvre le champ du rêve...
L'homme est un créateur qui fonde ce qu'il croit.
Et puisque la Nature aux lois mystérieuses,
Nous donnant la douleur, nous livra l'infini,
Pourquoi briserions-nous les ailes radieuses
Qui nous portent plus haut que notre ciel terni?
Pour moi, je te salue, Illusion féconde,
Qui seule à nos efforts viens prêter ta grandeur!
Sur les antiques fronts de tous les dieux du monde
C'est toi dont, à jamais, j'adore la splendeur.
O dieux des siècles passés!
Quand le monde rit et foule
Tous vos trônes renversés,
Je m'attendris et je songe
Que votre subtil mensonge
De l'Idéal qui nous ronge
Est le radieux flambeau.
Tous nos rêves dans votre ombre
Ont flotté, formes sans nombre,
Et votre gloire qui sombre
Met notre espoir au tombeau.
Heureux ceux que notre sphère,
En ses horizons étroits,
Peut désormais satisfaire,
Sous les cieux vides et froids!
Heureux ceux dont la pensée,
Parfois déçue et lassée,
Vers la chimère effacée
Ne se retourne jamais,
Et dont le rêve impassible,
Restreint au monde sensible,
Ne poursuit pas l'impossible
Jusqu'aux plus lointains sommets!
Pour moi, dans la vieille Égypte,
Je m'égare sans remords
Au sein de la sombre crypte
Où vivent toujours ses morts.
J'aime à croire qu'endormie
Dans l'étroite tombe amie,
La somptueuse momie
Songe encore aux jours anciens,
Et qu'en sa fixe prunelle,
Durant la vie éternelle,
Luit la vision charnelle
Des bonheurs qui furent siens.
Ou bien, sur les bords du Gange,
Dans un lumineux décor,
Je contemple un monde étrange
Et j'ai des ailes encor.
Parmi les temps insondables,
Mes destins inévitables
Par des nombres formidables
Comptent les ans révolus,
Car les siècles par centaines
Font les âmes incertaines
Dignes de boire aux fontaines
Où s'enivrent les élus.
Sous l'arbre au feuillage antique,
Je m'assieds avec Bouddha,
Épris du songe mystique
Dont la beauté l'obséda.
Là, sa douce âme pensive
Vit s'approcher, agressive,
La tentation lascive
Des corps éclatants et nus;
Ferme, il poursuivit sa voie,
Car l'éclair de notre joie
Est dérisoire et se noie
En des gouffres inconnus.
Parfois, dans la steppe aride
De l'Iran sec et poudreux,
Sur le désert, qui se ride
Vers l'horizon vaporeux,
Je distingue dans la brume,
Parmi l'air qui se parfume,
Une simple pierre où fume
Et flambe quelque tison:
De l'Arya des vieux âges,
Suivant ses pieux usages,
C'est là l'autel où ses sages
Murmurent leur oraison.
Des hauts remparts de Carthage,
Où la terre aux flots s'unit,
J'adore, un soir, sans partage,
Le front si pur de Tanit.
Dominant la mer tranquille,
Elle sourit, immobile,
Et sa puissance subtile
Enchante et dissout le cœur;
Ou bien son fin croissant grêle,
Effleurant quelque tourelle,
Semble, fantastique et frêle,
Un hiéroglyphe moqueur.
Et devant quelque humble toile
D'un vieux maître florentin,
Où les mages voient l'étoile
Qui blanchit dans le matin,
Je nais aux siècles gothiques,
Pour chanter de doux cantiques,
Sous les merveilleux portiques
Tout embrumés par l'encens,
Et pour baiser avec joie,
Sous le vitrail qui flamboie,
De Jésus, dont le front ploie,
Les membres éblouissants.
Non, je ne puis vous maudire,
Vous, nos charmeurs, vous, les dieux!
En vain le jour se retire
De votre ciel radieux,
De vous en vain mon cœur doute...
Pour éclairer notre route
Ce Demain, que je redoute,
Qu'a-t-il de meilleur que vous?
Dans notre existence brève,
Vaut-il mieux marcher sans trêve,
Ou s'enchanter d'un grand rêve,
Les mains jointes, à genoux?
Las d'avoir trop marché sous un soleil de feu,
Gautama, le doux prince aux yeux pleins de lumière,
Vit d'humbles murs surgir dans l'air ardent et bleu.
Ce n'était plus le temps de ses splendeurs mondaines,
Des repos nonchalants dans ses jardins fleuris,
Tandis qu'au bruit charmeur des sonores fontaines
Dansent rêveusement les lascives houris.
Il avait tout laissé des voluptés royales,
Car il ne pouvait plus les goûter sans remord
Depuis qu'il avait vu ces trois choses fatales,
Savoir: la pauvreté, la souffrance et la mort.
Recherchant le secret de la douleur humaine,
Durant des jours sans nombre il avait médité,
Et sur l'arbre où mûrit la science certaine
S'était formé pour lui le fruit de charité.
Dans ses rêves profonds sous le divin ombrage,
Lui, l'éternel Bouddha, venait d'apprendre enfin
Que l'homme, ignorant tout, a pour meilleur ouvrage
D'aimer, et de donner lorsque son frère a faim.
Maintenant il allait sous le ciel impassible,
Cherchant un malheureux pour lui prendre la main,
Et murmurant les mots de tendresse indicible
Qui devaient éclairer notre aride chemin.
Et voici que vers lui, la cruche sur l'épaule,
Venait, à pas lassés, la femme d'un soudra.
Le grand Réformateur alors comprit son rôle,
Un céleste sourire à ses lèvres erra.
Il vit en un éclair l'infranchissable abîme
Que la caste maudite entre les cœurs creusait
La femme que voilà ne pouvait pas sans crime
Approcher l'Aryen, dont l'orgueil l'écrasait.
Et c'était une atroce et honteuse souillure
Que rien dans l'avenir ne pouvait effacer,
Pour lui, que partager le pain ou bien l'eau pure
Avec celle qui, lente et triste, allait passer.
Et le prince du sang, dont la très noble race
Se peint sur son front blanc et dans son fier regard,
S'avance... Mais la femme, en hâte, lui fait place,
Puis, l'entendant parler, s'arrête, l'œil hagard.
Et Gautama disait, d'une voix dont la terre
Toujours, de siècle en siècle, entend l'écho sacré:
«J'ai soif, ma route est longue et l'âpre vent m'altère.
Penche vers moi ta cruche, ô femme! et j'y boirai.»
Mais elle, doucement, lui répliquait, confuse:
«Hélas! je suis en tout ta servante, seigneur;
Mais mon père est soudra. Vois quelle erreur t'abuse.
A boire par ma main tu perdrais ton honneur.
—«Femme, dit Gautama, je te demande à boire,
C'est tout. Ne me dis point que ton père est soudra.
Ces mots sont vanité, sœur, et tu peux me croire,
Car par ma voix demain le monde l'apprendra.»
Et la femme inclina, muette de surprise,
Sa cruche, et regarda cet homme au noble sang
Dont la lèvre effleurait la rude argile grise,
Et qui semblait joyeux de l'acte avilissant.
Elle ne savait pas, la pauvre dédaignée,
Que celui qui buvait, humblement, de sa main,
Verrait à ses autels la terre prosternée
Et plierait sous sa loi le tiers du genre humain.
Et lorsque, se perdant sur la poudreuse route,
Le voyageur eut dit son fraternel adieu,
Elle, qui le suivit d'un long regard sans doute,
Dans le passant songeur n'entrevit pas le dieu.
Près des limpides flots et des déserts de feu,
Sous l'insondable ciel étincelant et bleu,
Fleurit, naïve encor, la jeunesse du monde.
Là, dans l'enchantement des vivantes couleurs,
L'Humanité s'attarde au sein d'un calme rêve,
Car, du haut des autels, ses dieux veillent sans trêve,
Pour accueillir ses vœux et charmer ses douleurs.
Dans l'espace enflammé, les horizons mystiques
S'y déroulent sans fin parmi les rayons d'or.
Nul clairvoyant regard n'y peut sonder encor
Le sublime néant des visions antiques.
Le brahmane, approchant du Gange vénéré,
S'incline en sa ferveur que nul doute n'altère;
L'Arabe, balancé par le lent dromadaire,
Du prophète, à mi-voix, redit le nom sacré.
Sous les saints oliviers, le chrétien de Syrie
Évoque de Jésus le doux spectre sanglant,
Et rêve qu'il effleure en son baiser tremblant
Les pieds qu'ont arrosés les larmes de Marie.
Et d'infinis essaims de cœurs emplis de foi,
Ayant pour but l'amour et pour vertu l'aumône,
De l'aride Thibet aux bords du fleuve Jaune,
Serviteurs de Bouddha, suivent sa pure loi.
De leurs ardents espoirs ignorant la folie,
Ces peuples confiants, sans crainte et sans remord,
Ayant rempli leurs jours, s'endorment dans la mort
Sans avoir éprouvé notre mélancolie.
Dans l'avenir obscur, fermé d'un triple sceau,
Ils goûteront les biens que notre cœur jalouse:
L'orgueil des fils nombreux, la douceur de l'épouse,
Tous les simples bonheurs du monde à son berceau.
Affermis pour longtemps sur ces supports augustes
Que nos mains ont brisés sans trouver d'autre appui,
Et dédaignant le mal qui nous trouble aujourd'hui,
Ils resteront croyants, paisibles, fiers et justes.
Pour nous, près de trouver le vide sous nos pas,
Nous avons trop détruit sans bâtir assez vite.
D'amers pressentiments, que nul esprit n'évite,
A nos espoirs hautains livrent d'obscurs combats.
Et nous prêtons parfois, aux heures de ténèbres,
Une oreille inquiète aux lointains craquements
Dont le bruit, sourd encor, monte des fondements
De nos États vieillis, en des échos funèbres.
Crédules héritiers de l'humble et saint devoir,
Vous qui des dieux anciens ne touchez point les voiles,
Vivez, vivez heureux sous vos cieux pleins d'étoiles!
Vos rêves sont meilleurs que notre âpre savoir.
Nul ne sait quel triomphe à vos âmes candides,
Pour tant de patience, est peut-être promis.
Poursuivez donc en paix sous les astres amis
Votre songe éternel, au bord des mers splendides.
Les cieux élargissaient le terrestre horizon;
L'espoir d'un avenir plein d'extases sans trêve
Consolait de la vie incertaine et trop brève,
Et le désir vainqueur supplantait la raison.
Hélas! il est des cœurs que le Progrès consterne,
Des lèvres qui toujours invoqueront les dieux.
La Science à l'œil froid conduit l'esprit moderne,
Pourtant plus d'un genou dans l'ombre se prosterne,
Plus d'un regard encor monte au ciel radieux.
C'est que, nous retirant l'espérance qui charme,
Dévastant à jamais nos lointains paradis,
La Science n'a pas effacé toute larme;
En nos mains, au contraire, elle aiguise chaque arme,
Et nous rend sans pitié pour les combats maudits.
L'antique Illusion, qui nous devient néfaste,
Ne peut plus sans péril embellir le chemin.
Notre champ de bataille est si sombre et si vaste
Que jamais nulle haine ou de peuple ou de caste
N'en ouvrit de pareil au désespoir humain.
Le sang n'y coule point: la lutte pour la vie
N'offre point la grandeur des glorieux trépas;
Les morts, nul ne les chante et nul ne les envie,
Et l'effrayant clairon qui tous nous y convie,
C'est le cri de la faim, qui ne pardonne pas.
Nos tournois acharnés ont l'univers pour lice.
Sous nos efforts géants tout rempart est tombé.
Le salaire est une arme, un mot d'ordre, un complice.
Ni repos, ni pitié! Si son pied manque ou glisse,
Le lutteur le plus fort a bientôt succombé.
Car le travail, facile aux époques naïves,
Est pour nous l'incessant et terrible labeur.
L'esclave d'autrefois, dans nos cités actives,
Frémirait à l'aspect de nos races chétives,
Qu'asservissent le fer et l'or et la vapeur.
Il rirait de dédain quand leur foule pâlie,
Quittant le puits de mine ou l'obscur atelier,
Lui dirait: «Nous, au moins, sommes libres.» Folie!
Vous, libres?... Mais la loi qui vous dompte et vous lie
Plus qu'aucun joug humain vous contraint de plier.
Dans sa marche en avant le Progrès implacable,
Comme l'âpre Nature, écrase aveuglément
Le faible, l'impuissant, le rêveur, l'incapable.
Pour qui veut éluder son ordre redoutable,
Honte, misère et mort sont un sûr châtiment.
Pourtant l'homme jamais ne vivra sans chimère.
Nous aussi, nous avons notre espoir insensé:
Le rêve social, en son ardeur amère,
Prend des religions la puissance éphémère
Et remplace à lui seul tous les dieux du passé.
Nous le verrons bientôt plus qu'eux impitoyable,
Car il met l'idéal ici-bas, près de nous.
Pour toucher à ce but, qui paraît saisissable,
Le combat grandira, tellement effroyable
Que les maux d'aujourd'hui pourront nous sembler doux.
Puisque telle est la loi, courbons donc notre tête;
Mais ne maudissons pas, dans notre vain orgueil,
En face des douleurs que demain nous apprête,
Les dieux, dont la raison proclame la défaite,
Mais dont nos cœurs meurtris portent encor le deuil.
Au-dessus des brouillards d'argent, de cendre ou d'or,
Sur leurs trônes d'azur siégeaient les dieux sublimes,
Écoutant si vers eux nos chants montaient encor.
Ils étaient là, ces fils de notre immortel rêve,
Unis et fraternels dans leur commun séjour,
Car un même désir les enfanta sans trêve,
Car ils furent aimés du même ardent amour.
Ils étaient là, sans haine et sans amère envie:
Jupiter, Jéhovah, si prompts en leur courroux;
Le grand Baal; Istar, déesse de la vie,
Et le pâle Jésus sous ses longs cheveux roux;
Bouddha, dont la pitié s'épanche en flots mystiques;
Vishnou, qui de toute âme est l'éternel amant;
Allah, qu'ont célébré de belliqueux cantiques,
Et le farouche Odin, roi du Nord inclément.
Et sur les fronts hautains de la céleste foule
Régnaient le calme auguste et la sécurité:
Les siècles devant eux passeraient, sombre houle,
Mais sans pouvoir jamais ternir leur majesté.
Car l'homme, qui les fit du meilleur de son âme,
Et qui par leur splendeur s'était laissé charmer,
Quand il douterait d'eux ne serait point infâme
Assez pour les maudire et pour les blasphémer;
Mais, les enveloppant d'un respect doux et tendre,
Il bénirait toujours leurs fantômes puissants,
Qui l'ont fait espérer avant qu'il pût comprendre,
En lui donnant pour but les cieux éblouissants;
Il n'oublierait jamais que, sur sa route amère,
Eux seuls ont soutenu, guidé ses premiers pas,
Et qu'ils l'ont doucement calmé par leur chimère,
Comme on calme un enfant en lui chantant tout bas.
Ainsi rêvaient les dieux au fond du ciel immense,
Quand soudain, les troublant dans leur bleu paradis,
Monta comme un long cri d'insulte et de démence:
L'homme se disait libre... et les avait maudits!
Homme, pauvre insensé que mène un vain mirage,
Maudis donc ton cerveau, ton cœur et ta raison!
Les dieux ne sont-ils pas, réponds, ton propre ouvrage?
Qui donc les a dressés, hors toi, sur l'horizon?
Quand tu brandis contre eux un inutile glaive,
C'est ton illusion que menace ta main;
Si tu crois saluer une aube qui se lève,
Vois, tes propres flambeaux blanchissent ton chemin.
Va donc, poursuis un songe après un autre songe:
Tu ne peux échapper à la loi de ton cœur.
Mais écoute... Dans l'ombre où ton blasphème plonge,
C'est de ta seule voix que rit l'écho moqueur.
C'est toi, c'est ton passé, dont ainsi tu te railles.
Soit, tous tes dieux sont morts sous ton bras forcené;
Mais d'autres de ton sein vont naître, et tes entrailles
Demain feront jaillir ton rêve nouveau-né.
Où sont assis les dieux, ô Pallas-Athéné,
Daigne écouter l'accent de mon pieux cantique!
Reviens, reviens, Déesse, à la colline antique,
Fais resplendir encor ton temple profané!
Nous avons mutilé ton Parthénon sublime,
Nous, fils lourds et grossiers des Goths aux cheveux roux.
Ton pardon ne saurait effacer un tel crime.
De ses sombres erreurs notre race est victime;
Leur poids l'écrase encor, bien plus que ton courroux.
Mais du moins laisse-moi, noble Reine offensée,
Sur ton autel détruit verser mes pleurs amers!
Car il fut le sommet de l'humaine pensée.
Sitôt qu'il a péri, la nuit s'est abaissée
Sur ce triste Occident déchiré par les mers.
Mille ans elle a régné, la nuit épouvantable.
Tu te taisais alors et détournais les yeux,
O Raison, ô Beauté sereine et redoutable!
Lorsque fondit sur nous l'horreur inévitable,
Muette, tu voilas ta face au fond des cieux.
Le jour pourtant revint. Une tremblante aurore
Palpita tout à coup vers l'horizon sanglant.
Le vague écho lointain de ton clairon sonore,
O Vérité, passa, puis grandit plus encore...
L'Art ancien du tombeau surgit en chancelant.
C'est qu'une vision, pâle encore et divine,
Dans les cœurs torturés montait avec lenteur;
C'est qu'au souffle venu de ta sainte colline,
O Pallas-Athéné, sur le front qui s'incline
Planait le vol puissant de l'Idéal sauveur.
Le Moyen Age obscur tressaillit d'allégresse;
Le monde crut renaître en retrouvant tes lois.
Des vrais amants du Beau n'es-tu pas la maîtresse?
La Grèce nous inspire et tu guidas la Grèce.
Tous les grands siècles d'art sont éclos à ta voix.
Mais jamais l'Idéal, dont l'âme est altérée,
Qu'elle poursuit toujours et qui toujours s'enfuit,
Ne manifesta mieux sa présence adorée
Que dans l'antique Hellas, dans la terre sacrée,
Dont seul l'éclat splendide a vaincu notre nuit.
Jamais il ne trouva de plus parfait symbole
Que toi-même, ô Pallas: Beauté, Force et Raison!
Nul temple n'égala celui de l'Acropole.
Sous un clair ciel d'azur, merveilleuse coupole,
Quel peuple fier et doux remplissait ta maison!
Quels nobles citoyens, devant tes Propylées,
S'abordaient pour parler des dieux et des destins!
Leurs paroles de feu, dans l'espace envolées,
Enchantent aujourd'hui nos âmes consolées
Et sont le vrai flambeau de nos pas incertains.
Telle est ton œuvre immense, ô Reine salutaire!
Mais quelle ingratitude a payé tes bienfaits!
Ton culte a cessé d'être en honneur sur la terre,
Tu n'es plus qu'une idole, on rit de ton mystère.
Le respect des dieux pèse à nos cœurs imparfaits.
Ta force le cédait alors à ta douceur.
De pompeux cavaliers, en file solennelle,
Célébraient sur ta frise une fête éternelle,
Et chaque Athénienne était ta blanche sœur.
O Vierge! pour montrer ta face auguste et pure,
Pour mieux fixer les traits sous lesquels tu survis,
Tu créas Phidias... L'art passa la nature,
Et soudain tu parus, divine sous l'armure,
Toute d'ivoire et d'or au fond du saint parvis.
De ton sublime front, d'où la clarté ruisselle,
Sans cesse descendit dès lors la vérité.
De tes rayons brûlants quelque ardente parcelle
Chaque jour du génie alluma l'étincelle,
Et le monde ébloui vécut pour ta beauté.
Ton culte universel n'avait point de sceptique,
Tout mortel était prêtre à tes divins autels.
Euripide charmait les paysans d'Attique,
Et l'humble mendiant, assis sous ton portique,
Discutait de Platon les dogmes immortels.
Qu'il était donc aisé de suivre ta loi douce
Lorsque sur l'Acropole on pouvait t'approcher!
Mais le front de ton temple a roulé sur la mousse.
Toujours vers l'avenir notre destin nous pousse.
Où faut-il, où faut-il à présent te chercher?
Jamais nous n'atteindrons la grâce athénienne,
Minerve, car en nous survivent nos aïeux,
Durs guerriers, descendus de la Scythie ancienne,
Dont la fureur brisa cette ville, la tienne,
Où, fière, tu posais ton pied victorieux.
Que d'efforts il nous faut pour secouer une heure
Le lourd fardeau sanglant des siècles entassés!
L'abeille de l'Hymette en vain passe et m'effleure...
Pour moi, triste étranger, qui lutte, implore et pleure,
Ce doux frisson subtil, hélas! n'est point assez.
La pensée enfermée en ton front radieux.
Qu'es-tu? Qu'enseignes-tu, Vierge pure et hautaine?
Vois, mon âme est fervente et pourtant incertaine...
Découvre à mes regards ton sens mystérieux.
Toi que l'Amour jamais n'a trouvée accessible,
Toi dont le sang jamais sous ses dards n'a coulé,
Es-tu la Pureté, ferme, austère, inflexible,
Qui sur les chastes mœurs, sur le foyer paisible,
Pose des peuples forts l'empire inébranlé?
Mais n'es-tu pas, ô toi qu'invoquait Praxitèle,
Du génie enflammé l'étincelle de feu?
Dans ses moindres débris ton Parthénon révèle
Un tel souci du Beau, que nul peuple fidèle
N'offrit pareil présent en hommage à son Dieu.
Oh! si tu descendais de ta lointaine cime,
Dans le vide et la nuit las enfin de crier,
Nous courberions nos fronts sous ta règle sublime.
Vois, tous nos dieux brisés ont glissé dans l'abîme,
Pourtant nous ne pouvons désapprendre à prier.
Il s'éteint sans écho, le blasphème farouche
Par ce siècle hardi lancé contre le ciel.
La grâce du divin nous attire et nous touche,
L'infini nous reprend... Nous fermons notre bouche,
Mais notre cœur charmé chante un hymne éternel.
Minerve, c'est pourquoi les hommes de notre âge,
Las de leurs durs travaux, s'émeuvent à ton nom.
Dans nos songes troublés vient flotter ton image,
Et l'incrédule aussi, qui se croit le plus sage,
Pleure, et baise, incliné, le seuil du Parthénon.

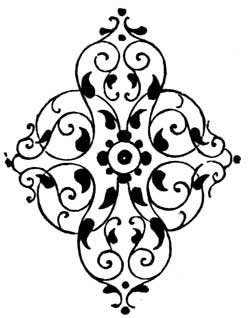
Sur cette terre esclave où notre règne croît,
Domaine familier, que nous trouvons étroit,
Et qui porte gravé, comme au front d'un portique,
Les mots de Vérité, de Justice et de Droit;
Tandis que notre esprit suit sa marche hautaine,
Que nos robustes bras se tendent pour l'effort,
Que notre cœur bondit, fier, amoureux et fort,
Trois maîtres sur nos seins scellent leur triple chaîne,
Savoir: l'Illusion, le Désir et la Mort.
Un jour ils m'ont parlé; j'ai connu leur empire,
Ce qu'ils font de la vie en ses instants trop courts,
Et l'ombre d'où je viens, et le but où je cours,
Et le fatal destin de tout ce qui respire...
Et chacun l'apprendra, car voici leurs discours:
Dit à mon pauvre cœur:
«Tu te crois libre et fort; tous les dieux, tu les braves...
Mais je suis ton vainqueur.
«C'est moi seul que tu sers. Pour moi tu te soulèves
A chaque battement.
Je te trompe à toute heure et transforme tes rêves
En un affreux tourment.
«J'éloigne pas à pas le bonheur qui te tente,
Et qui fuit sans recours.
Je fais se consumer en une vaine attente
Tes ans déjà si courts.
«Je corromps tes plaisirs, j'empoisonne ta joie,
Moi, le vrai Tentateur.
Tu m'adores pourtant, vil esclave, ma proie,
Lassé d'un Créateur.
«Si tu me renversais du trône inaccessible
Où les destins m'ont mis,
La Douleur et la Mort et le Temps invincible
Te deviendraient soumis.
«Mais je n'ai rencontré, parmi la multitude
Des aveugles mortels,
Qu'un seul audacieux dont la fière attitude
Menaçât mes autels.
«Celui-là posséda tous les biens que sur terre
J'inventai pour appâts:
Les trésors, le pouvoir, l'amour plein de mystère
Ont fleuri sous ses pas.
«Pourtant, détournant d'eux sa face auguste et triste,
Bouddha, l'homme divin,
Sut que par la folie humaine je subsiste
Et que mon culte est vain.
«Il voulut arrêter l'éternelle hécatombe
Où se plaît ma fureur;
Toute vie est à moi, seule avec moi la tombe
Rivalise d'horreur.
«Il voulut arracher de ma griffe sanglante
L'adolescent joyeux,
L'homme fait, le vieillard à la tête branlante,
Que j'enivre le mieux.
«Il dit: «Mort au Désir!... Tout désir est un leurre.
«Sans cesse inapaisé,
«L'homme attend l'avenir, ou se retourne et pleure
«Ce qu'il a méprisé.
«Celui qui dans son sein éteindra l'âpre flamme
«Vivra semblable aux dieux,
«N'ayant jamais ni vœux ni regrets dans son âme,
«Ni larmes dans ses yeux.»
«Ainsi parlait Bouddha, le seigneur doux et sage;
Et depuis ce moment
Plus d'un astre rapide a marqué son passage
Au fond du firmament;
«Plus d'un dieu s'est levé, pour la pensée humaine,
Dont le trône est tombé.
Moi seul, moi l'Éternel, qui la dompte et la mène,
Je n'ai pas succombé.
«Car je suis le Désir, qui tue et renouvelle,
Père de tout effort:
Sous mon fouet hurle et court l'humanité rebelle...
Je l'entraîne à la mort.»
Quand mon cœur, tourmenté par l'éternel Désir,
Reconnaissait enfin le vide et le mensonge
Des biens toujours fuyants qu'il avait cru saisir.
J'étais las de l'attente et las de l'espérance,
Je voulais, oubliant qu'il est un lendemain,
Recueillir jour à jour avec insouciance
Chaque fragile fleur éclose en mon chemin.
J'enviais le long rêve et la fierté tranquille
De l'animal errant sous les bois ténébreux,
Qui n'a jamais connu le salaire servile
Ni du labeur sans but porté le joug affreux.
J'écoutais, dans l'écho des siècles éphémères,
S'élever les accents du seul sage ici-bas,
De Bouddha, qui disait: «Renonce à tes chimères,
Par ton renoncement cesseront tes combats.»
Et je croyais toucher la sphère souveraine
Où sont assis en paix les dieux indifférents,
Qui, sans rire ni pleurs sur leur face sereine,
Ont vu nos jours amers s'écouler par torrents.
C'est alors que, troublant mon impassible rêve,
Au bord d'un ciel en feu surgit l'Illusion,
Dans le sang du soleil, sur l'éclatante grève
Que trace en l'or des soirs la nue en fusion.
Et sa voix me cria: «Qu'importe la sagesse?
Qu'importe la douleur? O misérable humain,
Ton néant résigné vaudra-t-il ma richesse?
J'ai tes amours, ton ciel et tes dieux dans ma main.
«C'est moi qui t'ai conduit dans la nuit des vieux âges;
J'ouvris devant tes yeux l'espace illimité;
Soumise à tes désirs, j'ai pris mille visages;
J'ai, dans ton froid tombeau, mis l'immortalité.
«Parce que tu saignas sur ce chemin de gloire,
Et parce que ton sein se gonfla de sanglots,
Tu cesses désormais d'espérer et de croire,
Tes dieux sont vraiment morts et l'avenir est clos!
«Pose donc sur ton cœur une invincible armure,
Sonde avec un œil sec l'austère vérité...
Tu me retrouveras au fond de la Nature,
Moi, ton Illusion,—seule réalité!
«Car je suis la Maya triomphante, éternelle!
Tes sens et ton esprit n'obéissent qu'à moi,
Je colore à tes yeux toute forme charnelle,
Je suis dans ton plaisir, je suis dans ton effroi.
«Quand tu crois progresser, c'est ton rêve qui change;
Et si ton cœur se ferme, impassible et hautain,
Même alors je t'aveugle en ton orgueil étrange.
Adore-moi, mortel, car je suis ton destin!»
Qui vous prétendez des dieux!
C'est moi qui tiens des atomes
Le creuset mystérieux.
Désir, Illusion vaine,
Servez votre souveraine:
Que votre puissance entraîne
L'homme enivré vers la Mort!
Sans vous il pourrait connaître
La misère de son être,
Et, se refusant à naître,
Il trahirait mon effort.
«Cachez-lui par vos chimères
L'ombre immense où je l'attends,
Et, sous les cieux éphémères,
La fuite de ses instants;
Qu'il vive, pense et s'efface
Sans déchiffrer sur ma face
Le but sombre qu'à sa race
J'assigne au fond du tombeau.
Me livrant sa chair lassée,
Qu'il croie—audace insensée!—
Me dérober sa pensée
Comme un immortel flambeau.
«Parez l'obscure matière
A ses regards éblouis;
Qu'il y puise la lumière
Et des concerts inouïs.
Moi, qui dissous la substance,
Je sais qu'en son inconstance
L'universelle existence
Est la Force en mouvement.
Dans ce tourbillon sans trêve,
Qu'importe la forme brève!
Je ne détruis qu'un vain rêve,
Je crée éternellement.
«En sa morne indifférence,
Ma terrible activité
Ne connaît point la souffrance,
La gloire ni la beauté.
J'ai l'infini pour domaine.
L'altière raison humaine,
Qu'un mirage trouble et mène,
Me coûte à décomposer
Juste autant, lorsqu'en vient l'heure,
Qu'un souffle qui passe et pleure
40Ou la corolle qu'effleure
L'insecte sans s'y poser.
«Le masque affreux dont on couvre
Ma sublime majesté,
La face osseuse où s'entr'ouvre
Un rictus épouvanté,
Les yeux creux, le crâne blême,
Me sont donnés pour emblème
Par ceux à qui mon problème
Reste à jamais inconnu.
Car tout être qui respire
Contre ma grandeur conspire,
Et pour vanter mon empire
Nul n'est jamais revenu.
«L'insensible molécule,
Seule, est sans crainte en mes mains;
Mais tout ce qui vit recule
Devant mes sombres chemins.
La personnalité lâche
En vain s'oppose à ma tâche:
Je transforme sans relâche
Tous les éléments divers.
Gloire à moi! gloire à la tombe!
Tout en surgit, tout y tombe.
Sur l'éternelle hécatombe
Je construis les univers.»
Un austère présent, digne d'elle et de nous,
Un sombre objet, choisi dans l'hypogée antique
Que garde le colosse au front superbe et doux,
Assis dans le désert, les doigts sur ses genoux.
Ce présent, c'est la main délicate et raidie
D'une reine, portant—voilà bien trois mille ans—
Sur sa tête petite, élégante et hardie,
Avec le bandeau d'or brodé de feux tremblants,
La vipère divine aux yeux étincelants.
Cette main—quand la femme aux longs yeux ceints de bistre,
Fille des Pharaons, belle et jeune, vivait—
Dans le fond des parvis faisait frémir le sistre
Devant le dieu, vers qui ce bruit seul arrivait,
Ne troublant point le songe éternel qu'il rêvait.
Ou bien elle tenait—la main frêle et mignonne—
Un lourd sceptre massif à la crosse d'or fin,
Dont l'ombre dominait le désert monotone
Et, sur l'âpre étendue où les lions ont faim,
Loin du grand Nil d'azur, se prolongeait sans fin.
Lorsque les courtisans, nombreux, comme une houle,
Encombraient du palais les larges escaliers,
Cette petite main, ils la baisaient en foule,
Elle qui, levant un de ses doigts déliés,
Pouvait faire tomber leurs têtes par milliers.
Et souvent, dans la paix des nuits calmes et chaudes,
Sur la terrasse haute où meurt tout bruit de cour,
Sous la lune faisant luire ses émeraudes,
Lente, elle errait, la main si douce, au fin contour,
Parmi les noirs cheveux d'un prince fou d'amour.
Ces choses se passaient voilà trois mille années.
Elle est là, cette main, parmi mes bibelots.
Sa grâce, sa fierté sont encor devinées:
Aussi, des temps lointains bravant les sombres flots,
J'évoque à son aspect de magiques tableaux.
Pauvre petite main de royale momie,
Dont l'aromate encore a d'étranges parfums,
Je t'aime... je te prends comme une main d'amie.
Loin du présent morose et des jours importuns,
Emmène-moi, veux-tu? vers les soleils défunts.
Hélas! ma main de chair, ma main vivante et rose
Qui sur la bandelette autour de ton poignet
Ou sur tes maigres doigts sans nul effroi se pose,
Doit vivre moins que toi, que l'Égypte craignait
Et sauva par les soins que son art enseignait.
Mes doigts vivants, à moi, se réduiront en cendre,
Et les tiens garderont leur exquise raideur.
La tombe où promptement il me faudra descendre
Des sépulcres du Nil n'a point la profondeur,
Car la mort est chez nous, ô Reine, sans grandeur.
Reste au moins avec moi durant ma courte vie,
Petite main rigide et que baisait un roi.
Ce qui t'a fait frémir et ce qui t'a ravie,
Vois, après trois mille ans m'enchante ainsi que toi:
De l'éternel amour c'est l'éternel émoi.
Au bord du large Nil les lions viennent boire,
Car l'homme en ce désert n'est plus seul souverain.
Elle est morte, la ville aux cent portes d'airain.
Le rude Assyrien, le dur Sardanapale,
Qui prend son prisonnier tout vif et qui l'empale,
Lui qui s'enorgueillit de mille atrocités,
A foulé sous ses pas la reine des cités.
Passant, muet et fier, de portique en portique,
Il a par ses dédains rendu l'insulte antique.
Son cœur s'est dilaté... Car n'est-il pas le fils
Des aïeux que Thoutmès vainquit à Karkémis?
Depuis, Ninive en vain, haïe et solitaire,
S'était bien haut dressée au-dessus de la terre,
Mettant son pied vainqueur sur la nuque des rois,
Sans pouvoir effacer l'injure d'autrefois.
L'Égypte, avec son prince au visage d'éphèbe,
L'Égypte altière et douce avait conservé Thèbe.
Saignante et divisée, elle montrait toujours
La ville éblouissante, avec ses deux séjours,
Tous deux aussi remplis d'étonnantes merveilles,
Les tombes au palais étant toutes pareilles,
L'un peuplé des vivants, l'autre où rêvaient les morts.
Et Ninive y songeait ainsi qu'à son remords.
Cette Thèbe!... Elle était comme un songe, un grand mythe,
Que n'avait vu jamais l'œil d'un guerrier sémite.
Pour la cité hautaine il n'était nul danger
Pire que recevoir un impur étranger.
Et voici, cet opprobre est donc tombé sur elle!
L'Égypte s'est brisée ainsi qu'un roseau frêle,
Comme l'avaient prédit les prophètes des Juifs.
Thèbe, Thèbe est détruite, et les lotus plaintifs,
Seuls, quand le vent du soir les froisse au bord des ondes,
Y réveillent l'écho des ruines profondes.
Ammon, dieu protecteur! Soleil, divin flambeau,
Qui te couches ainsi que l'on entre au tombeau,
Et qui, chaque matin, dans l'aube solennelle,
Montes, gardien sacré de la vie éternelle,
Parle, et dis par quel crime inconnu, dieu jaloux,
Ta ville sainte a pu mériter ton courroux!
Toi pour qui se dressaient—marchepieds, autels, trônes—
Ses temples merveilleux et ses larges pylônes,
Ses monstrueux piliers dans l'ombre des syrinx,
Toi pour qui s'alignaient à l'infini ses sphinx,
Tu l'as donc repoussée et n'as plus voulu d'elle!
Et Thèbe, cependant, te demeure fidèle.
Ils se sont tus, c'est vrai, les hymnes d'autrefois;
Le carnage a réduit au silence les voix;
L'atroce Ninivite aux narines farouches
En arrachant les cœurs a su fermer les bouches;
Sur la cité splendide où tu régnais, toi seul,
Les sables du désert étendent leur linceul;
Dans l'éclatant midi ta cruelle lumière
Montre le palais vide et l'autel en poussière,
Et nul n'affronte alors ton visage irrité,
O Soleil!... Mais à l'aube, où ta douce clarté
Glisse si tendrement sur la ville en ruines,
Semblant la baigner toute en des pitiés divines,
Quand tes premiers rayons effleurent ses sommets,
Elle, qui t'adora sans se lasser jamais,
Sent dans son sein meurtri son grand amour renaître.
Elle s'apaise, oublie... et sourit à son maître.
Et dans la plaine rose, aux lueurs du matin,
Le Colosse au regard perdu dans le lointain,
Qui peut fixer sur toi sa prunelle de pierre
Et qui te voit surgir sans baisser la paupière,
Dans son sein de granit déchiré trouve encor
Un chant harmonieux pour le cher Soleil d'or.
Finissent lentement les sombres agonies,
Et la Mort, dans le sang et la pourpre du soir,
L'une après l'autre éteint les prunelles ternies.
Rhamsès le Grand, debout sur son char, veut savoir
Des rebelles tribus qu'il a si bien punies
Combien de vaillants fils, leur joie et leur espoir,
Jonchent des monts hautains les pentes infinies.
Car il faudra l'inscrire au temple de Louqsor,
Pour que vers l'avenir il prenne son essor,
Ce nombre glorieux d'existences fauchées.
Aussi, devant le roi, les scribes attentifs
Comptent l'épais monceau des mains droites tranchées,
Qui monte et monte encor sous les grands cieux plaintifs.
Une coupe en sa main, le roi Sardanapale
Repose, ayant au front le rubis et l'opale.
Le pampre autour de lui forme un vert corridor.
Il songe aux ennemis dont il brisa les nuques,
Faisant couler leur sang comme un rouge nectar
Sur l'autel éclatant de la divine Istar.
Et l'éventail palpite aux mains de ses eunuques.
Il ne fut point en vain courageux et fervent,
Il n'a point invoqué sans raison la déesse:
L'Élamite a cédé sa terre et sa richesse,
Et soudain s'est enfui comme la paille au vent.
Et l'orgueilleux vainqueur compte dans sa pensée
Les dépouilles sans nombre, et les troupeaux sans fin
Qui rapportent l'albâtre et l'argent et l'or fin
Des palais tout fumants de Suse renversée.
Il rit, car il revoit, dans son clair souvenir,
Les prisonniers se tordre en d'horribles supplices,
Et les griffes de fer déchirer les chairs lisses,
Et de l'orbite noir l'œil frémissant jaillir.
Il sait qu'en ce moment aux remparts de Ninive
Pendent des pieds, des mains et de sanglantes peaux.
Lui, dans ses beaux jardins, trouve doux son repos,
Car l'épouvante enfin tient la terre captive.
Et devant lui, très droite et rose de bonheur,
Sur un siège pompeux, sa jeune souveraine,
L'épouse de son choix, sourit, belle et sereine,
Se demandant à quoi rêve son cher seigneur.
Elle a pendant longtemps pleuré de son absence,
Regrettant les baisers de l'effroyable roi
Et murmurant le nom, qui jette au loin l'effroi,
De ce nouvel Assur, qu'on craint et qu'on encense.
Et ses yeux, ses grands yeux aux longs cils de velours,
Contemplent, enivrés, le visage inflexible
Qu'ils ont vu, dans les nuits à l'extase indicible,
Souvent pâlir de joie en ses noirs cheveux lourds.
Ainsi tous deux, assis à l'ombre des grands arbres,
Elle amoureuse enfant, lui conquérant hautain,
Dans leurs songes perdus, achèvent leur festin,
Et le soleil couchant colore au loin les marbres.
Sans un geste, autour d'eux les muets serviteurs
Restent, pleins de respect, ainsi que des statues;
Même, instinctivement, les harpes se sont tues,
Éteignant par degrés leurs accords enchanteurs.
Mais—leçon qu'à l'Asie il faudra qu'on enseigne—
Aux branches d'un palmier, près de ce couple heureux,
Et de son col tranché montrant le disque affreux,
La tête de Teumman, le roi de Suse, saigne.
Bien que père déjà, la tresse des enfants [C],
Du grand temple de Phtah descend la large rampe.
Râ, l'éternel Soleil, dans les cieux triomphants,
Quittant, jeune et joyeux, le sein d'Isis sa mère,
Monte au fond des déserts aux sables étouffants.
Et l'antique Memphis, où rien n'est éphémère,
Plus haut que ses palais élève ses tombeaux,
Dont l'ombre inviolée enferme sa chimère.
Mais Satni-Khamoïs, aux traits calmes et beaux,
Soudain a vu passer sous les brillants portiques
Une femme aux yeux vifs ainsi que deux flambeaux.
Couverte de joyaux aux figures mystiques
Et de longs vêtements brodés d'un très grand prix,
Comme cortège elle a de nombreux domestiques.
Le prince, à son aspect, s'est arrêté, surpris:
Ses longs yeux sont si doux, sa bouche si hautaine,
Qu'un désir invincible entre en ce cœur épris.
Il est le fils du roi, la conquête est certaine.
Puis ce n'est, après tout, qu'un caprice léger.
Il suit la jeune femme en sa marche lointaine.
«Mon père à cette ville est, dit-elle, étranger.
C'est un homme puissant, grand-prêtre de Bubaste.
Je suis pure. A mon lit il ne faut point songer.»
Lui, qui vit dans l'orgueil, dans la pompe et le faste,
Et qui jamais encor n'éprouva de refus,
L'aime pour sa pudeur et sa fierté de caste.
Ce fils des Pharaons se trouble, tout confus.
Son front, qui sera ceint de la double couronne,
Rougit... Mais il proteste en longs propos diffus.
Elle, un éclair aux yeux, sourit et lui pardonne.
Ses lourds cheveux tressés tombent sur son col nu;
Ses anneaux, en marchant, font un bruit monotone.
Elle dit simplement et d'un air ingénu:
«Je m'appelle Taïa. Viens dans notre demeure.
Tu me respecteras, puisque c'est convenu.»
Lui, sent qu'il va la vaincre ou qu'il faut qu'il en meure.
Tous deux ont traversé le large bras du fleuve,
Sur la rive duquel s'ouvrent les bleus lotus.
Taïa songe à conduire habilement l'épreuve;
Sa lèvre rouge garde un pli mystérieux.
L'œil ardent de Satni de sa beauté s'abreuve.
Dans la riche maison il entre, curieux.
Les murs sont recouverts d'onyx et d'émeraude.
Il suit la chaste fille au doux front sérieux.
Elle va jusqu'en haut. L'atmosphère plus chaude
Se charge de parfums pénétrants et subtils.
Elle éloigne d'un geste une esclave qui rôde.
Ils sont seuls maintenant... Seuls! Et que disent-ils?
Satni n'ordonne point, il sanglote et supplie...
Elle, de son réseau tend et serre les fils.
Voici que s'ouvre enfin sa lèvre si jolie:
«Je suis pure. Il me faut, si je cède, tes biens,Que tu me donneras pour ma honte accomplie.»
Et le prince répond: «Oui, si tu m'appartiens,
Tu posséderas tout, mon or, mes fines pierres,
Mes perles, mes émaux, mes coursiers syriens.
—«Signe-le,» dit Taïa sans baisser les paupières.
Satni voit ces lenteurs d'un œil triste et farouche;
Mais elle, rit toujours, et ne se livre pas.
«J'ai, dit-il, tout à l'heure apposé mon cartouche
Sur la donation que de moi tu voulais,
Viens, ne résiste plus, car j'ai soif de ta bouche.»
Elle reprit: «Là-bas, dans tes lointains palais,
Tu possèdes, je crois, des enfants légitimes;
Et les miens, si j'en ai, deviendront leurs valets.
—«Non, dit Satni, je puis combler tous les abîmes.
Je serai roi, Taïa, je serai maître un jour.
Tes fils ne naîtront point pour être des victimes.»
Alors Taïa lui fit jurer par son amour
Grondant au fond de lui comme un fauve qui râle,
Qu'il ferait de leurs fils des princes à sa cour.
Et Satni le jura, les yeux fous, le front pâle.
Leurs sièges ont pour pieds des griffes de panthère,
Et dans leurs coupes d'or coulent des vins choisis.
Taïa contraint Satni haletant à se taire.
Lente, elle prend des fruits et prétend avoir faim;
Son grand œil sombre est plein d'un irritant mystère.
Un souple aspic d'argent orne son poignet fin.
Son pied foule un tapis qui vient de Babylone.
Ce repas, il faudra pourtant qu'il prenne fin!
Près de cet homme au sang jeune et vif qui bouillonne
Elle garde un visage impassible et très froid,
Comme un masque d'Hathor en haut d'une colonne.
Lui, qui souffre, pourtant l'aime ainsi, car il croit
Qu'elle ignore encor tout de l'ivresse insensée;
Et la force lui manque, et son désir s'accroît...
Alors Taïa sourit à sa propre pensée.
«Tes enfants, dit Taïa, sont venus de la ville.
—Mes enfants?...» Il tressaille et s'étonne, anxieux.
Elle, dont le beau corps cache une âme très vile,
Sait qu'enfin le moment décisif est venu
De dompter tout à fait l'amant lâche et servile.
Elle ouvre sa tunique et montre son sein nu,
Puis son bras merveilleux sort de la mousseline;
Tout son vêtement glisse, à peine retenu.
Ce qu'il recouvre encor, le prince le devine...
Alors l'infortuné, muet, tombe à genoux,
Ne pouvant qu'adorer cette forme divine.
Et Taïa, se penchant, lui dit d'un ton très doux:
«Fais mourir tous tes fils, les miens auront ton trône...Puis ôte, si tu veux, tous ces voiles jaloux.»
Il crie, et tend les mains comme pour une aumône.
Parmi les draps soyeux que son corps souple froisse,
Taïa met la splendeur de ses membres nacrés.
Satni, n'espérant plus que son amour décroisse,
Pour l'assouvir enfin n'a prononcé qu'un mot...
A présent du jardin montent des cris d'angoisse.
Blême, le prince laisse échapper un sanglot;
Mais Taïa le regarde, impérieuse et tendre...
Sous sa prunelle aiguë il s'apaise aussitôt.
Tout se tait... Aucun bruit ne se fait plus entendre.
Qui portaient comme lui la tresse sur la tempe,
Pour la femme qu'il vit, sous les cieux triomphants,
Du grand temple de Phtah gravir la large rampe.


Tout en rêvant, choisi quelques sauvages fleurs,
Pour leurs ardents parfums et leurs vives couleurs,
Et les ai dans mes vers côte à côte enchâssées.
Hélas! mes durs sonnets les tiennent oppressées;
Elles perdent en eux leur sève et leurs senteurs,
Elles qui, dispersant leurs souffles enchanteurs,
Ondulaient librement par le vent balancées.
Je vous fais don pourtant de leur bouquet pâli;
Vous y reconnaîtrez le reflet affaibli
Des amples floraisons écloses dans votre âme.
Et vous saurez aussi que mon cœur enivré,
Épuisant dans leur sein leur arome de flamme,
Bat plus calme et plus fort pour l'avoir aspiré.
Parfois nous repeuplons nos Olympes déserts:
Erreur des aïeux morts hantant nos cœurs mystiques!
Le Temps, dernier des dieux, chancelle au sein des airs.
L'atome, obéissant aux forces despotiques,
Dans l'abîme infini n'a point d'âges divers;
L'horloge suspendue aux éternels portiques
Marque une heure immuable à l'immense univers.
Le passé, l'avenir—inconstantes chimères—
Troublent par leurs aspects des êtres éphémères
Qui naquirent hier et périront demain.
Quel sens auraient ces mots pour la matière sombre,
Qui, soumise à jamais aux changements sans nombre,
N'a point eu d'origine et n'aura point de fin?
L'homme, en sa gratitude ou ses vagues effrois,
Des astres bienfaisants adorait la lumière,
Et du vaste univers il les proclamait rois.
De ces faux souverains, rigide justicière,
La raison depuis lors a renversé les droits,
Et nous les a montrés, ces amas de poussière,
Signes mystérieux des forces et des lois.
Eux, qui régnaient jadis, tombent sans espérance.
Ils ne sont que la vive et splendide apparence
D'un principe caché toujours en mouvement.
Nos sens ont inventé leurs beautés éternelles;
Leurs fantômes glacés peuplent le firmament,
Leur grâce et leur éclat naissent dans nos prunelles.
Songeant aux êtres vils qui peuplèrent les eaux,
Nous disons: «Dieu frappa plus d'une race immonde,
Puis il fit naître l'homme après les grands oiseaux.»
Et plus tard, entr'ouvrant quelque couche profonde,
Et trouvant dans le sol les débris de nos os,
Un enfant plus parfait de la terre féconde
Reniera notre sang, notre âme et nos travaux.
Pourtant nous sommes fils des monstres de l'abîme,
Et d'héritiers plus purs l'Humanité victime
A son tour périra pour leur donner le jour.
La route du progrès pas à pas est suivie.
Dans l'univers, ainsi qu'en notre étroit séjour,
S'enchaînent sans repos les formes de la vie.
Qui régit tout progrès, c'est la loi du plus fort.
L'être imparfait périt; marâtre impitoyable,
La Nature l'écrase et poursuit son effort.
Partout est engagé le combat redoutable;
A l'heure harmonieuse où la terre s'endort,
Il rend la nuit sinistre et l'ombre épouvantable,
Tout brin d'herbe est un champ de carnage et de mort.
L'angoisse de la faim, qui toujours hurle et gronde,
Est le ressort puissant jouant au cœur du monde,
Et celui qui dévore est l'élu du destin.
L'esprit même naquit des brutales entrailles;
Et la rivalité du repas incertain
Fait surgir l'avenir en de sombres batailles.
La voici qui murmure et court sur les cailloux.
Tout enfants, autrefois, dans sa nappe légère
Nous avons en riant miré nos fronts si doux.
Aussi n'est-elle point à nos cœurs étrangère;
Nous lui disons tout bas: «Te souviens-tu de nous?»
Quoi! ne savons-nous pas que l'onde est passagère?
Sans cesse un flot s'enfuit devant un flot jaloux.
Par son aspect charmant c'est encor notre source;
Mais, changeante toujours en sa rapide course,
Peut-elle être aujourd'hui ce qu'elle fut hier?
Et notre âme, elle aussi, se transforme à tout âge.
Qu'est-ce donc après tout que notre Moi si fier?
Rien qu'un vain souvenir dans une frêle image.
Pour exister longtemps il faut périr toujours;
Chaque instant la détruit, la forme fugitive
Dont la beauté si chère enivre nos amours.
La Mort délivre enfin la matière captive,
Lui rouvrant l'univers et ses vastes séjours:
D'une nouvelle vie, intense et moins chétive,
Elle anime nos corps au terme de nos jours.
Vie et Mort: grands mots creux et mensongers fantômes!
Pleurons-nous aujourd'hui les frémissants atomes
Qui formaient autrefois le sang de notre cœur?
Où sont-ils? Dans l'air pur, dans l'herbe, dans les roses...
Et quand la Mort sur nous mettra son doigt vainqueur,
Pourquoi craindrions-nous d'autres métamorphoses?
Homme, insecte orgueilleux, cesse de blasphémer!
De tes sens imparfaits reconnais l'esclavage:
Concevraient-ils Celui qui les a pu former?
Ce Dieu, que, d'après toi, je renie et j'outrage,
Ne l'offenses-tu point quand tu prétends l'aimer?
Tu lui prêtes ton cœur, tes haines, ton langage,
Et de tes passions tu le veux animer.
Moi, devant sa grandeur je m'incline en silence.
Lorsque son soleil d'or sur mon front se balance,
J'admire le rayon dont la splendeur a lui;
Car le soleil est fait de poudre et me ressemble.
Mais Dieu, qu'il règne ou non, que saurais-je de lui?
Et qui de nous l'insulte, ô chrétien! que t'en semble?
Ont placé l'âge d'or au berceau des humains?
Nous avons vu s'éteindre, en nos lentes conquêtes,
Les siècles par milliers sur nos sombres chemins.
Nous avons combattu de monstrueuses bêtes,
Nous avons labouré le sol avec nos mains,
Nous avons succombé dans de mornes défaites
Sans avoir entrevu les brillants lendemains.
De l'animalité nous dégageant à peine,
Alors que nous traînons encor sa lourde chaîne,
Pourquoi ce vain regret allant vers le passé?
L'avenir seul est plein de visions sublimes.
Puisqu'un si profond gouffre est enfin traversé,
C'est qu'il n'est plus pour nous d'inaccessibles cimes.
Vit placer la Raison sur les divins autels;
Pourtant la froide reine, aux foules prosternées,
Ne saurait imposer des décrets immortels.
Son règne achèverait soudain nos destinées;
Contre le sphinx obscur nous cesserions nos duels;
Quittant leurs vains espoirs, nos âmes résignées
Ne s'élanceraient plus vers de merveilleux ciels.
Car nous marchons guidés par un sublime rêve
Qui, flottant à nos yeux et reculant sans trêve,
Se transforme toujours, mais sans pâlir jamais.
Et les Sentiments seuls, en nous prêtant des armes,
Nous mènent à l'assaut de tous les hauts sommets.
Pour conquérir les cœurs, Jésus versa des larmes.
L'aube se lèverait au fond d'un ciel en deuil;
L'océan de nos jours, n'ayant plus de mystère,
Sous chaque flot d'azur nous montrerait l'écueil.
L'enfance songerait à la vieillesse austère,
L'heure semblerait courte et proche le cercueil;
Las des vaines amours, l'homme irait solitaire,
En d'ingrats descendants ne prenant plus d'orgueil.
Voyant toujours grandir les limites du monde,
Le savant suspendrait la poursuite profonde
Du mirage imposant qu'on nomme Vérité;
Le prêtre se tairait dans l'église déserte;
Et, cessant tout effort, la triste Humanité,
Pensive, s'assoirait devant sa tombe ouverte.
Indestructible Espoir d'un bonheur inconnu,
Une fausse sagesse en vain veut qu'on te brise,
Dans le fond de nos cœurs tu fleuris, ingénu.
C'est toi qui nous conduis sur la route entreprise,
Qui nous fais accomplir un progrès continu,
Et chaque vin d'amour dont notre âme se grise
De ton fruit immortel à longs flots est venu.
Par toi, dont le pouvoir les inspire et les fonde,
Mille religions ont consolé le monde,
Les martyrs ont chanté, voyant le ciel ouvert.
Ce siècle se croit grand parce qu'il te renie:
Ta forme change,—hélas! nous en avons souffert,—
Mais rien ne détruira ton essence infinie.
L'esprit, dans ses destins, n'agit qu'au second rang.
Les sentiments acquis, partage héréditaire,
Lentement transformés, coulent avec le sang.
Le type originel siècle à siècle s'altère;
Un trait parfois subsiste et s'en va grandissant;
Puis tout à coup surgit un héros solitaire
Qui saisit en sa main ce levier tout-puissant.
Un désir, un besoin, un espoir, une haine,
Tels sont les fondements de la puissance humaine,
Et tout ce qu'on élève est bâti là-dessus.
L'être qui laisse au monde une immortelle trace,
Qu'il soit César, Bouddha, Mahomet ou Jésus,
Incarna dans son sein le rêve d'une race.
Qui soumettait Dieu même à des décrets hautains,
Et qui nous le montrait, d'une plume fringante,
Balançant le succès des combats incertains.
Toi que nous avons vue, injuste et provocante,
Couronner les héros avec des airs mutins,
Tu t'arrêtes, troublée en ta candeur piquante,
Devant l'enchaînement terrible des destins.
Aujourd'hui tu pressens ta rude et noble tâche;
L'immense drame humain se poursuit sans relâche,
Sur chaque événement il pèse tout entier.
Lève-toi donc, déesse, et de tes orteils roses
Foulant les durs cailloux d'un âpre et long sentier,
Remonte lentement vers les lointaines causes.
Nous nous sommes raillés de ta diversité,
Parce que tu suivais, perfectible et sincère,
Dans tous ses lents progrès la faible Humanité.
Pour t'avoir vue ainsi varier sur la terre,
Notre esprit contre toi souvent s'est révolté,
Mère des foyers purs, ô reine salutaire,
Qui nous donnes la force et la félicité!
Viens poser sur nos fronts ton joug doux et paisible.
Nulle marche en avant aux peuples n'est possible
Si de tes ordres saints ils n'écoutent la voix.
Tu vaux à nos cités mieux que vingt citadelles.
Apprends-nous à lutter en affirmant tes droits,
Pour qu'un jour sans effort nos fils te soient fidèles.
Parfois, en relisant tous vos noms oubliés,
Je songe que nos cœurs à vos froides poussières
Par des fils infinis et puissants sont liés.
Muets, vous dirigez nos volontés altières;
Par vos désirs éteints nos désirs sont pliés;
Vos âmes dans nos seins revivent tout entières,
En nous vos longs espoirs vibrent, multipliés.
Bien que nous franchissions une sphère plus haute,
Vos antiques erreurs nous induisent en faute,
Nous aveuglant encor malgré tous nos flambeaux.
Car le passé de l'homme en son présent subsiste,
Et la profonde voix qui monte des tombeaux
Dicte un ordre implacable, auquel nul ne résiste.
Ce n'est pas que mon cœur s'assouvisse ici-bas:
Qu'il s'épuise et qu'il saigne en d'horribles combats,
Tu n'en souris pas moins, implacable et sereine.
Ce qu'il t'importe, à toi, c'est que la moindre graine
Trouve un sol favorable et germe sous tes pas.
Ton éternel souci, qui ne me connaît pas,
N'a pour but que la vie obscure et souveraine.
La vie!... Et que ce soit la mienne, avec ses pleurs,
Ou l'humble éclosion des bêtes et des fleurs,
Ou le rayonnement des astres dans l'espace,
Nature, ton ardeur et tes soins sont pareils.
Pourquoi donc plaindrais-tu ce qui souffre et qui passe,
Toi qui vois s'enflammer et mourir les soleils?
Roulent un sang troublé par d'antiques douleurs,
Et puisque nos enfants, héritiers de nos pleurs,
Naîtront pour s'irriter en des angoisses vaines,
Accourez donc, des bois, des îles et des plaines,
O peuples dont le front ignore nos pâleurs,
Sauvages, qui vivez comme vivent les fleurs,
Aux vents libres et purs emmêlant vos haleines!
Hommes au teint de cuivre et d'ébène, venez!
Rouvrez donc l'avenir à ces infortunés
A qui nous léguerons demain nos défaillances.
Ah! rendez à nos fils la sève d'autrefois,
Pour qu'à notre savoir ajoutant vos vaillances,
Votre rire puissant éclate dans leurs voix.
Son orgueil a dressé, vers la face des cieux,
Au néant, le défi le plus audacieux
Qui jamais ait surgi de nos âmes timides.
Quand seront condensés les éléments humides
Sur notre globe éteint, froid et silencieux,
Ces monuments hardis d'un rêve spécieux
Survivront seuls, debout dans les déserts numides.
Or ils furent construits en l'honneur de la Mort.
C'est un suprême instinct qui dicta cet effort:
La Mort transforme, crée, et n'a point d'épouvante.
Chaque temple verra s'obscurcir son flambeau,
Car tous les dieux mourront... La Mort seule est vivante,
Et ce qui doit rester sur terre est un tombeau.
Ah! le savoir au moins, ce serait bon, pourtant!
Voir le but, quel qu'il soit, rendrait enfin content
Le cœur humain, gonflé d'espoir et de colère.
Si tout n'est pas perdu de l'œuvre séculaire,
Nous lutterons encor, jour à jour, en chantant,
Pour porter jusqu'aux cieux l'édifice éclatant
Du progrès éternel, que le temps accélère.
Hélas! le besoin vil d'apaiser notre faim,
La lutte pour la vie, est la suprême fin
Vers qui tend tout l'effort de nos âmes hautaines.
L'esprit subtil y va par des chemins divers,
Et, malgré la fierté des visions lointaines,
Nos douleurs sont sans fruit pour l'immense univers.
Naît, évolue et meurt, et pour un court moment
Peut croire qu'elle existe et se meut librement,
Quand la Force, en ses jeux universels, l'active.
Inerte esclave aussi, notre terre chétive,
D'un Tout mystérieux parcelle en mouvement,
Se proclamait jadis centre du firmament,
Nommant éternité son heure fugitive.
Et l'être humain, soumis à l'ordre illimité,
Seul veut sauver encor sa personnalité.
Mais de l'astre à l'atome à nos yeux tout s'enchaîne.
Il s'efface, le rêve à notre orgueil trop doux.
Entre le berceau frêle et la tombe prochaine,
L'éclair de notre vie, hommes, n'est point à nous.
Qui sont nôtres, mon cœur ému se glace en moi,
Car c'est un sort étrange, amer et plein d'effroi
Celui que subit l'homme en ses courtes années.
Vers un but inconnu ses forces détournées
N'obéissent jamais un instant à sa loi;
Il souffre, pleure et lutte, et ne sait pas pourquoi,
Car il voit au néant ses œuvres condamnées.
Si la terre demain s'arrêtait dans son cours,
C'en serait fait de l'être et du temps et des jours.
Un seul choc!... et soudain tout redeviendrait flamme.
Où donc seraient alors la gloire, le progrès,
Le renom du guerrier, la beauté de la femme?
Pourquoi tant espérer s'il n'est plus rien après?
Haussez-vous sur les monts que le soleil redore,
Et vous prendrez plaisir à voir plus haut encore.
Th.-A. d'Aubigné, les Tragiques, l. VII.
Du découragement universel, amer,
A l'heure où le soleil sous le flot d'or se plonge,
Un poète songeait, l'œil fixé sur la mer.
Il domptait le désir d'épancher sa souffrance
En des chants tout remplis d'un enivrant poison,
De maudire à grands cris la dernière espérance
Qui, trompeuse, erre encore au bord de l'horizon.
S'interdisant la plainte, il eût voulu se taire,
Rester, comme ce soir, à contempler les flots,
Et croire, malgré tout, qu'il est un grand mystère
Que notre âme verra quand nos yeux seront clos.
Mais le rêve incertain, qui calmait son supplice,
N'endormait point en lui l'ardente charité;
De l'angoisse éternelle il se sentait complice
S'il n'apportait au monde un mot de vérité.
Quoi! pensait-il, lui, par des vers,
Lorsque rien ne se recommence,
Rajeunir le vieil univers?
Dans notre main sèche et ridée,
La coupe du songe est vidée.
Pour le triomphe d'une idée
Qui lutte encor de notre temps?
On a pesé même la gloire:
Inscrire un vain nom dans l'histoire,
Quel plaisir creux et dérisoire!
Tout s'estime en deniers comptants.
Et l'art aussi suit la fortune.
Allons, poète, allons, debout!
Laisse la morale importune,
Et songe à flatter notre goût.
Nous sommes las de tes névroses,
Triste rimeur aux airs moroses;
Ton rôle est d'effeuiller des roses
Sur le front de l'humanité.
Quitte ton accent de prophète,
Viens prendre part à notre fête,
Descends de ce sublime faîte
Où t'eût placé l'antiquité.
Ainsi, dans l'abîme du doute,
Bruissait un écho railleur.
Sombres luttes que l'on redoute!
On en sort bien pire ou meilleur.
Et le poète à l'âme austère,
Malgré l'angoisse solitaire,
Rêvait d'entr'ouvrir à la terre
Des chemins nouveaux, éclatants...
Essor tragique!... Une hirondelle
Ainsi voudrait à tire-d'aile
Entraîner sa race infidèle
Qui ne croirait plus au printemps.
Crêpe léger, voilant l'immensité des eaux,
Une voix du rêveur troublé fut entendue,
Pure comme la brise à travers les roseaux.
Lente, elle s'élevait du côté de la terre,
Si distincte, malgré le grand bruit des flots noirs,
Qu'elle couvrit bientôt leur tumulte, et fit taire
Au cœur qui l'écoutait les plaintifs désespoirs.
Elle disait: «O toi, plié comme l'arbuste,
Quand, près de le briser, souffle le vent des mers,
Poète, lève-toi, ta douleur n'est pas juste,
Car, moi, je n'ai jamais trouvé les cœurs amers.
«Puisque tu veux conduire et relever les âmes,
Puisqu'un désir ardent d'idéal t'obséda,
Prends ma voix, prends mon nom, mes rayons et mes flammes
Et jette alors bien haut ton cri: Sursum Corda!
«Tu verras qui résiste ou seulement recule.
Quand je ne serai plus le grand motif humain,
Poète... oh! viens alors t'asseoir au crépuscule,
Seul, et les yeux en pleurs, et le front sur ta main.»
Elle se tut. Croyant à l'erreur d'un beau songe,
Lui fils des songes d'or, il dit: «Qui donc es-tu?
Un Dieu?... Mais ils s'en vont. L'homme a mis son mensonge
Dans la bouche des dieux. N'es-tu pas la vertu?
«Sous quel nom t'invoquer? Réponds-moi, doux fantôme!
Que ton accent est pur! Où donc l'ai-je entendu?
Es-tu femme?... L'espoir t'accompagne... Un tel baume
Aux lèvres d'une femme est parfois suspendu.
«Parle encore!...» Il allait poursuivre sa prière,
Quand, descendant du ciel, ô prodige inouï!
Belle comme l'aurore à la fraîche lumière,
Elle apparut aux yeux du poète ébloui.
C'était bien une femme, en effet, mais si chaste,
Si hautaine et si douce en sa sérénité,
Que les astres, la terre, et la mer sombre et vaste,
L'accueillirent, surpris, d'un murmure enchanté.
Son front semblait trop fier pour aucune couronne.
On pressentait, à voir son bras fort et charmant,
Le geste qui brandit et le geste qui donne,
Et l'étreinte d'amour au long frémissement.
Ses yeux, ses yeux profonds, abîmes de tendresse,
Devaient, étant si doux, avoir connu les pleurs:
Ce que nous adorons, nous, si pleins de détresse,
A toujours, femme ou dieu, partagé nos douleurs.
Telle elle descendait, merveilleuse figure!
Devant ses pas s'ouvraient de lumineux chemins;
Et le poète, atteint par cette clarté pure,
Enfin cria: «Patrie!» et tendit ses deux mains.
Quand toute antique foi qu'un nom sacré décore
Penche au cœur des mortels,
—Ainsi qu'on voit le soir, à travers les bruines,
Sur le sommet des monts s'incliner les ruines
Des plus hautains castels,—
«Je puis, car nulle bouche encor ne me blasphème,
Rallumer dans vos seins l'étincelle suprême
Des éternels espoirs;
Faire vivre en luttant, faire aimer les supplices,
Faire braver la mort et trouver des délices
Aux plus âpres devoirs.
«Je puis, dans les cœurs bas qui rampent près de terre,
Que le vin des plaisirs chaque jour désaltère,
Que l'égoïsme clôt,
Je puis, moi, soulever, pour peu que je le veuille,
Plus aisément que l'air ne soulève la feuille,
Un sublime sanglot.
«Nul œil n'a mesuré le cercle que j'embrasse,
Je façonne à loisir le corps, l'esprit, la race,
Et la religion.
Mais mon nom te suffit. Je suis pour toi la France!
On dirait, n'est-ce pas? l'écho du mot souffrance...
Pourtant mon lot fut bon.
«Il fut bon, étant rude et coupé pour ma taille.
C'est moi qui vais devant dans la grande bataille
Du progrès rayonnant.
Je veux continuer ce rôle magnifique,
Et j'ai peur du sommeil obscur et pacifique
Qui règne maintenant.
«Élève donc la voix, parle à mes fils, poète,
Car je souffre, et, perdus dans le bruit de leur fête,
Ils ne le savent pas.
Parle... ils arrêteront, s'ils voient que mon sang coule,
Dans les tristes chemins où s'engouffre leur foule,
L'essor fou de leurs pas.
«Tu leur diras: Je viens au nom de la Patrie.
Frères, entendez-la! C'est elle qui vous prie...
Ce jour est solennel.
Tous vos vices mesquins, races exténuées,
Effacent lentement, là-haut, dans les nuées,
Son sourire éternel.
«Vous avez découvert que l'existence est brève,
Que la mort, ce néant, succédant à ce rêve,
N'ouvre rien au delà;
Et vous avez pensé: «L'heure présente est bonne,
«Elle seule est à nous, demain n'est à personne:
«Jouissons, tout est là.»
«Vivre dans le présent, c'est être en décadence.
Vingt peuples, délaissant leur antique prudence,
Ont ainsi trébuché;
C'est en chantant qu'ils ont glissé dans la nuit noire;
De leurs débris encore—ô leçons de l'histoire!—
L'univers est jonché.
«Décadence!... O Français! un siècle est peu de chose;
Pourtant, depuis cent ans, quelle métamorphose
Dans nos vœux, dans nos mœurs!
La terre, en écoutant, voilà cent ans à peine,
Un jour prit pour des voix d'aube encore incertaine
Nos confuses rumeurs.
«On vit comme un reflet d'éternelle lumière;
Nous avions fait soudain rayonner la chaumière,
Dans les champs, sous les cieux;
Nos cœurs, tout enflammés d'intentions sublimes,
Vers les plus nobles buts et les plus hautes cimes
Volaient, audacieux.
«Jamais à si longs traits on ne but l'espérance.
Avec quel front levé, quelle fière assurance,
Nous parlions de demain!
Nous tracions jusqu'à Dieu, dans le temps et l'espace,
Peuple prédestiné, triomphateur qui passe,
Notre royal chemin.
«Nous fondions la vertu, l'amour et la justice;
Nous trouvions de la joie au fond du sacrifice,
Même sans nuls témoins.
Nos cœurs se sont lassés de ces biens invisibles;
Dans nos seins aujourd'hui, pour qu'ils battent paisibles,
Il leur faut beaucoup moins.
«Ah! que ne sommes-nous, en ces jours héroïques,
Morts comme nous savions mourir alors, stoïques,
Souriant au tombeau,
Vaincus des rois ligués, écrasés par leur nombre,
Mais vers les nations tendant à travers l'ombre
Un immortel flambeau!
«Ce flambeau, dans nos mains il vacille, ô mes frères!
Non, nous ne sommes plus les soldats téméraires,
Chantant au bord du Rhin,
Voulant conquérir moins des villes que des âmes,
Remplaçant volontiers par des hymnes de flammes
Les lourds canons d'airain.
«Sursum Corda!... Là-haut nos cœurs et nos pensées,
Vers ce ciel, rayonnant de nos gloires passées,
Ce beau ciel radieux,
Ce ciel de France, où semble errer une âme douce
Vers qui celui qu'on frappe et celui qu'on repousse
Tournent toujours les yeux.
«Hélas! ce ciel profond, l'on vous dit qu'il est vide,
Que nul Dieu n'y sourit, que votre cœur, avide
D'espoir, vous a trompés.
Frères, lorsque sa foi s'éteint, un pays tombe.
Voyez donc, voyez donc à creuser quelle tomb
Vos bras sont occupés!
«Mais l'infini toujours hante nos cœurs frivoles.
On dit: «Je ne crois plus,» et devant mille idoles
On fléchit les genoux.
L'une au moins, la Patrie, est si pure et si belle
Que les siècles ont vu presque abdiquer pour elle
Le Dieu fort et jaloux.
«Le culte des Romains, leur vrai culte, fut Rome;
Et jamais sentiment ne fit au cœur de l'homme
Germer rien d'aussi fort.
Leur antique vertu rend leur triomphe juste;
Ils posèrent le trône éblouissant d'Auguste
Sur des siècles d'effort.
«Nul revers n'abattait leur constance obstinée.
Imitons-les. Ayons en notre destinée
Cette invincible foi.
Notre œuvre vaudra mieux que leur sombre conquête:
Sur le cœur qui consent notre puissance est faite
D'amour et non d'effroi.
«Nous sommes les voyants, les chercheurs, les apôtres;
Quand c'est nous qui crions: «Sursum Corda!» les autres
Lèvent un front riant;
Car ils ont cru soudain voir luire en leurs ténèbres
L'étoile qui guidait durant les nuits funèbres
Les mages d'Orient.
Le rediront ensuite avec leurs voix profondes.
N'ont-ils pas répété
Après nous: «Dieu le veut!» dans des âges farouches?
Et, plus tard, nous avons mis dans leur mille bouches
Le grand mot Liberté!
Vers l'Idéal portant l'immortelle couronne,
Seul Dieu qui nous guida,
Vers l'art, vers la science aux lueurs souveraines,
Vers la fraternité, vers la bonté, ces reines,
Français, Sursum Corda!»

Ma vie est tout entière en votre vague émoi.
Dans la nuit du passé, votre écho tendre ou triste
Sauve seul du néant cet être qui fut Moi.
Sans vous, qu'en serait-il de mes courtes années,
S'effaçant tour à tour dans le temps éternel,
Et des illusions, si promptement fanées,
Dont l'éclat met une âme en mon corps tout charnel?
Car il n'est rien de vrai dans toutes les chimères
Qui, de leur vol léger, flottent sur mon chemin:
Elles sont les reflets, brillants mais éphémères,
Du l'univers au fond d'un organisme humain.
Mes sens, miroirs subtils de ces formes sans nombre,
Eux-mêmes, je le sais, n'ont point de fixité,
Mais changent leurs tableaux, rayonnants ou pleins d'ombre,
Comme un fleuve mouvant par sa course emporté.
Dans mon cœur frémissant, dans ma chair douloureuse,
Ce qui le mieux échappe à l'incessante mort,
A l'évolution puissante et ténébreuse
Qui partout en secret active son effort,
C'est ce qui n'est pas moi: l'ineffaçable trace
Qu'a gravée en mon sein la foule des aïeux.
Ma joie et mes douleurs sont celles de ma race,
Et le feu de son âme éclate dans mes yeux.
Que devient donc ma vie en ces profonds mystères?
Où retrouver ce Moi, qui périt chaque jour?
O souvenirs! c'est vous, aux heures solitaires,
Qui du frêle fantôme esquissez le contour.
C'est vous qui me rendez quelquefois à moi-même,
Ombres qui reflétez l'ombre éteinte à jamais,
Car vous ressuscitez en un songe suprême
Tout ce qui m'a fait vivre et tout ce que j'aimais.
Nés avec chaque larme, avec chaque pensée,
Partout où j'ai souffert, partout où j'ai vaincu,
Vous maintenez pour moi l'existence effacée,
Par vous seuls je peux dire aujourd'hui: «J'ai vécu!»
Venez donc, souvenirs à l'aile étincelante,
Spectres des jours heureux et des paisibles soirs,
Venez, pour enivrer mon âme chancelante
Des bonheurs disparus et des anciens espoirs.
Vous que le temps revêt d'un invincible charme,
O mes meilleurs amis! ô mon plus sûr trésor!
Vous paraissez plus beaux à travers une larme,
Aussi d'un œil mouillé je poursuis votre essor
Au hasard de mes vers, parmi les rythmes d'or.
Troublantes pour le cœur comme un parfum pervers,
Avec le charme atroce et les douceurs cruelles
De nos longs souvenirs en ce vieil univers?
Qui donc découvrira des mots subtils et rares
Dont nos fibres tout bas vibrent à se briser,
Puisque le sourd écho de nos langues barbares
Ne dit point l'infini du songe et du baiser?
L'excès de notre ivresse et de notre souffrance
Semble animer la voix des forêts et des flots,
Mais nous, pour égaler leur sauvage éloquence,
Nous n'avons que l'accent éperdu des sanglots.
Oh! je voudrais trouver des paroles légères
Dont le son vague et doux, suave et déchirant,
Dise au cœur ce que dit sous les longues fougères
La brise qui, le soir, les frôle en murmurant.
Et je voudrais rimer des vers dont la magie
Ferait défaillir l'âme, avec l'aigu frisson
Qu'éveille, fredonné vers la fin d'une orgie,
L'air tant aimé jadis d'une ancienne chanson.
Et je voudrais encore, oh! je voudrais connaître
Un langage disant les infinis regrets
Et l'éternel désir de ce qui pourrait être,
Du bonheur inconnu qui ne viendra jamais.
Les bois ont la voix
De l'onde.
Dans son lit amer
Ainsi geint la mer
Profonde.
J'écoute... Le vent
Dans le pin mouvant
S'engouffre.
Tel se plaint le flot,
C'est bien le sanglot
Du gouffre.
L'âpre souffle mord
Le hêtre et le tord
Sans peine,
Puis s'en va, hurlant,
Rendre tout tremblant
Le chêne.
Dans ces hauts abris,
On dirait les cris,
Très aigres,
Des mâts de vaisseaux,
Qui sont sur les eaux
Si maigres.
Les sombres taillis
Sont tous assaillis,
O lutte!
Par des vents diserts,
Y jouant des airs
De flûte.
Doux, tendres, puissants,
Les bruits incessants,
En foule,
Se mêlent sans chocs.
Ainsi pleure aux rocs
La houle.
O grand univers!
Tes échos divers,
Pour l'âme,
Ont la même voix:
Les gouffres, les bois,
La lame.
Que nous disent-ils
Dans leurs chœurs subtils?
Qu'importe!
Ce n'est qu'un vain bruit,
Et le vent qui fuit
L'emporte.
Sur notre orgie en feu lançant son souffle amer.
Il est nuit. L'Opéra, vers qui chacun se rue,
Ressemble au roc heurté par les flots de la mer.
Des carrosses bruyants déversent la cohue:
Fracs noirs, paillettes d'or, maillots couleur de chair.
La danse de Carpeaux se déroule, éperdue,
Sentant les murs frémir d'un rythme ardent et cher.
Et la limpide lune, au doux rayon bleuâtre,
Met une lueur pure au front de ce théâtre,
Où s'essouffle, en hurlant, le plaisir effréné;
Tandis que, dans la houle humaine qui ruisselle,
Un garde de Paris, par le froid étonné,
Se tient, raide et muet, et grave, sur sa selle.
Font, dans les soirs pensifs, monter des pleurs sacrés,
Sont fiers, purs et puissants comme ces dieux de pierre
Que d'un suprême orgueil la Grèce avait parés.
Incompris de la foule, à des lèvres vulgaires
Ils n'ont point appelé de faciles sanglots.
Les douleurs dont votre âme a pu saigner naguères
N'obscurcissent jamais leurs sublimes tableaux.
L'égoïsme d'un cœur qu'un âpre amour déchire
Y chercherait en vain des baumes fraternels,
Car ils ne daignent pas regretter ni maudire
Vos vers d'airain chantant sous les cieux éternels.
Sur la fuite des jours et le néant des choses
Ils construisent en paix leur songe de beauté,
Et l'esprit ignorant les invisibles causes
Ne connaîtra jamais le prix qu'ils ont coûté.
Mais l'âme qu'enchanta leur ivresse profonde
Voit, sous la majesté des impassibles vers,
Palpiter l'idéal invincible du monde
Et ruisseler les pleurs de ce vieil univers.
Août 1890.
Ce soir, dans les sentiers étroits pour nos chevaux.
Nous étions égarés loin du bruyant rallye,
Et vous me racontiez votre mélancolie
De l'accent pénétré que prennent les dévots.
Et je me défendais, par ma gaîté railleuse,
De comprendre trop bien vos douces oraisons.
Vous m'aviez fait quitter notre bande joyeuse
Par un galop sournois dans la forêt ombreuse,
Et le soleil quittait les hautes frondaisons.
Le long du chemin creux, tout rouge de bruyère,
Nous allions maintenant, rapprochés, pas à pas.
Sous les massifs profonds défaillait la lumière,
Et le recueillement de la nature entière
Nous fit, sans y songer, soudain parler tout bas.
Et moi, je me plaisais à ce brin d'aventure:
C'était gracieux, fin, joli... presque touchant.
J'ai ri, car j'aime à rire, et c'est bien ma nature;
Mais ne me croyez pas trop folle créature...
Non, je m'attendrissais, tout en vous le cachant.
Mais quoi! de vos chagrins je connais trop la cause.
Moi, j'ai souffert aussi, tout en riant toujours.
Hélas! rien n'en guérit, ni les vers, ni la prose,
Ni le jeu, ni l'oubli, ni rien, ni quelque chose,
Ni les longs cheveux d'or, ni les yeux de velours.
Qu'importe! Souffrez donc, puisqu'un instant de joie
N'est jamais—dites-vous—chèrement acheté,
Et que, parmi ces maux dont nous sommes la proie,
Éclate par éclairs le bonheur qui les noie,
Le bonheur d'un moment qui vaut l'éternité.
Vous aurais-je donné cette heure bienfaisante?
Peut-être... et c'eût été plutôt l'illusion.
L'Illusion!... Voilà la grande complaisante.
Hier, quand nous causions, elle était là, présente,
Dans les reflets pourprés du ciel en fusion.
Que faut-il donc de plus pour que l'âme se grise?
Un bon cheval, un soir embaumé, vaporeux,
Un charmant tête-à-tête obtenu par surprise,
Un horizon lointain qui pâlit et s'irise,
Et la rouge bruyère au bord d'un chemin creux.
Sur les champs de jeunes blés verts,
Sur les prés, où l'œil se fatigue,
Ébloui par leurs tons divers.
Dans la touffe de trèfle rose
Éclate un bouton d'or en feu;
La marguerite, large éclose,
Est auprès du liseron bleu.
De tous côtés la terre blonde
Se montre nette et de niveau,
N'attendant pour être féconde
Que le don d'un germe nouveau.
Au flanc des collines, barrière
Élevée à notre horizon,
Se creuse la blanche carrière,
D'où va naître quelque maison.
Le sentier poudreux se dessine,
Courbé par un bouquet de bois.
On sent un parfum d'aubépine,
On entend bruire des voix.
Et la campagne est solitaire;
Ce chaud paysage d'été
Est plein du rêve et du mystère
De quelque monde inhabité.
Dans sa demeure close et fraîche,
Le paysan, les membres las,
Fuit un instant l'haleine sèche
Qui flétrit les derniers lilas.
Mais parmi l'herbe déliée
Où commence le sillon noir,
Une charrue est oubliée:
Voici la vie et le devoir.
La couronne de la forêt,
Jaunie et flétrie, est foulée
Sous le pied du passant distrait.
A cette parure enlaidie,
Dépouille des beaux jours défunts,
Par moments la brise tiédie
Vient dérober d'âcres parfums.
Dans la plaine, où flotte et se pose
Un touchant et dernier rayon,
Le laboureur grave dispose
La charrue au bout du sillon.
Sur un peuplier, malgré l'heure,
Des feuilles frémissent encor;
Un soleil pâle les effleure,
Et l'on dirait un arbre d'or.
Les vignes courent, avalanches,
Du haut des coteaux jusqu'en bas,
Et dressent dans les brumes blanches
Leurs milliers de noirs échalas.
Au loin passe une silhouette
Au mouvement discret et lent:
C'est un chasseur, dont le chien guette
Le lièvre en son gîte tremblant.
Les prés, que l'humidité ronge
Et colore d'un brun sanguin,
Portent en ligne qui s'allonge
Les meules hautes du regain.
Et, comme une âme désolée,
Là-bas fuit dans le ciel profond
La silencieuse volée
Des hirondelles qui s'en vont.
Je reste un moment à songer,
Quand le jour vient de disparaître
Et qu'au fond du ciel on voit naître
La blanche étoile du berger;
A cette heure calme et bénie,
C'est que j'aime entendre dans l'air
Monter la rumeur infinie
De Paris, confuse harmonie,
Semblable à celle de la mer.
Ce bruit, fondu par la distance,
De tant de voix, de tant de pas,
Est-ce un chant? une plainte immense?
Je ne sais... J'écoute, et je pense
Au flot bleu qui brise là-bas.
Si quelquefois sur la falaise,
En été, je reste à rêver,
Lorsque le vent du soir s'apaise
Et n'est plus qu'un souffle, qui baise
Nos cheveux sans les soulever,
C'est qu'à mes pieds l'Océan gronde,
Éternellement agité,
Et qu'au murmure de son onde
Je songe à la clameur profonde
Montant d'une grande cité.
Océan, que nous veux-tu dire?
Sont-ce là des hymnes, des cris?
L'âme du monde qui soupire?
Je ne sais... J'écoute, j'admire,
Et je me souviens de Paris.
O vaste mer! ô ville immense!
Mes deux muses, mes deux amours,
Ne gardez jamais le silence!
Je me tais en votre présence,
Mais vous, pour moi, parlez toujours!
Et le vent de la haute mer,
Comme un faucheur abat sa gerbe,
Y courbe l'herbe
D'un souffle amer.
Moi, contre qui le roc se dresse,
Et qui vais toujours en avant,
J'aime, quand parfois il me presse,
L'âpre caresse
De ce grand vent.
Il me repousse, et je m'obstine;
Malgré son effort irrité,
Je gravis l'altière colline,
D'où je domine
L'immensité.
Ma vie, ainsi je l'ai comprise:
Chemin hardi, falaise en fleur,
Puis, troublant mon âme surprise,
La rude brise
De la douleur.
J'aime cette haleine sauvage,
Que rien ne saurait apaiser,
Et qui souvent sur mon visage
Pose avec rage
Son froid baiser.
Je me sens grandir dans la lutte.
O vent glacé! tu peux rugir:
Ce front, à ta fureur en butte,
De nulle chute
Ne doit rougir.
Mon pied est sûr et je m'élève;
Je vois reculer l'horizon...
Et j'ai, pour ce combat sans trêve,
Quitté ma grève
Et ma maison.
A toi, petite Georgette, quelques
jours avant ta naissance.
Aube qui n'as point lui, fleur qui n'es point éclose,
Incertain et charmant trésor,
A ton éveil, je veux que mes rimes fidèles
Palpitent sur ton front avec des frissons d'ailes,
Comme un essaim d'abeilles d'or.
Hélas! elles n'ont pas le pouvoir de ces fées
Qui paraissaient soudain, d'une étoile coiffées,
Aux jours fabuleux d'autrefois,
Et qui, d'un geste lent de leurs mains gracieuses,
Faisaient pleuvoir en dons leurs faveurs précieuses
Sur les berceaux des fils de rois.
Elles n'ont pas surtout, dans leur vain bruit qui charme,
L'émoi délicieux de ta première larme,
Ni l'accent de ton premier cri.
Comparant à ta voix, qu'elle brûle d'entendre,
Leurs longs rythmes pesants, ta mère heureuse et tendre
De pitié sans doute a souri.
Qu'elles aillent pourtant chanter ta bienvenue!
Qu'elles prennent leur vol sur la route inconnue
Où descendront tes pas tremblants!
Elles seront pour toi d'un bienfaisant présage,
Et leur souffle, la nuit, baisera ton visage,
Sous tes rideaux légers et blancs.
Elles diront, enfant, par leur grâce éphémère,
A cette enfant tout près de devenir ta mère,
Que les amis des premiers ans,
Quand on sut les aimer fidèlement, comme elle,
Pour les grouper ensuite autour d'un berceau frêle,
Sont les plus riches des présents.
Elle est la fée, enfant: c'est elle qui te donne
Les vieilles amitiés, rayonnante couronne
De son joli front confiant.
Dans ce monde où tu viens, rien ne vaut la tendresse.
Tes yeux purs s'ouvriront sous la chaude caresse
De notre amour vivifiant.
Viens, tout est prêt pour toi, petit hôte candide:
Nos cœurs et nos baisers, et ta couchette vide,
Qui rit dans l'appartement clair;
Les mignons vêtements de batiste et de soie,
Et les larges rubans dont le tissu chatoie,
Bleu d'azur ou rose de chair.
Devant ces doux objets, l'œil se trouble et se mouille,
Mon vers ému se tait. L'oiselet qui gazouille
Encor manque au nid triomphant.
Les vœux montent du cœur à la lèvre qui tremble...
Sois fort, sois bon, sois simple et sois fier tout ensemble,
Et sois heureux, petit enfant!
Octobre 1884.
Est entré dans un cimetière.
Ses pieds nus ont heurté la dalle d'un tombeau;
Il grelotte, assis sur la pierre.
Il a peur, il appelle... Et le vent de la nuit
Éteint sa voix tremblante et douce.
Dans l'ombre, tout est blanc et muet... Et, sans bruit,
Des ombres glissent sur la mousse.
Devant lui, s'accoudant au bloc brisé d'un fût,
Dans des colonnes ruinées,
Une d'elles s'arrête... une d'elles qui fut
Une vierge de seize années.
Elle n'a vu jamais cet enfant rose et nu,
Dont l'œil mutin de pleurs se mouille;
Jamais, non... même pas dans un rêve ingénu
Que l'aurore joyeuse embrouille.
Elle ne connaît pas tous les savants baisers
Qu'ont inventés les lèvres souples;
Elle ne frémit pas, alors qu'inapaisés
Sanglotent les spectres, par couples.
Donc elle ouvre tout grands ses yeux creux et pensifs
Devant ce petit être étrange,
Et s'étonne qu'il ait des airs aussi plaintifs
Puisque sans doute c'est un ange.
Lui, saisi de respect pour ce fantôme pur,
Immaculé comme les marbres,
N'ose lui demander un chemin court et sûr
Pour fuir parmi les mornes arbres.
Pourtant, dompté soudain par de poignants effrois,
Il prend sa main si pâle et frêle...
Puis, tous deux, ils s'en vont sur les noirs gazons froids,
Où le grillon jette un cri grêle.
Or l'âme qu'habitaient les neigeuses candeurs
Et les ignorances sublimes,
Croit, en touchant l'enfant, glisser aux profondeurs
De très vertigineux abîmes.
Car elle a reconnu l'invincible pouvoir
Auquel fut soustraite sa vie;
Tous les amers plaisirs qu'elle vient d'entrevoir,
Ce sont eux, eux seuls qu'elle envie.
Et voici que bientôt paraît à son esprit,
En souvenir impérissable,
Un jeune homme aux traits fiers, qui jadis lui sourit
Et traça son nom sur le sable.
Elle comprend alors qu'elle n'a point vécu,
Et son regard morne retombe
Sur cet enfant, par qui l'univers est vaincu
Et qui règne encor dans la tombe.
Elle peut maintenant, en hâte, mais en vain,
Le mener hors du cimetière,
Hélas! car c'en est fait de son repos divin
Pour l'éternité tout entière.
Seule, enchante toujours nos cœurs vieillis et las.
Seuls, vous nous demeurez des choses d'ici-bas
Dont la grâce fragile usa notre tendresse.
Sur la route assombrie et pleine de détresse
Où, chancelants et lourds, posent nos derniers pas,
Vous flottez, doux et chers, et nous parlez tout bas
Du passé, qui s'éveille avec votre caresse.
L'air d'autrefois, l'arome aux exquises fadeurs,
Ébranlent tout à coup l'âme en ses profondeurs,
Lui rendant l'aiguillon des poignantes délices.
Pour vivre heureux encore, en un songe abîmés,
Jusqu'au bord du tombeau nous avons pour complices
Les sons et les parfums que nous avons aimés.
Et dans le fond des cieux le jour s'est retiré,
Comme un époux fermant la chambre nuptiale.
Vers le monde obscurci, tour à tour attiré,
Chaque regard d'en haut, tombant de chaque étoile,
Se tourne, et fait pâlir le poète inspiré.
La volupté puissante ôte en riant son voile...
Et le tambour du pitre, au bord du grand chemin,
Très tard ébranle encor la baraque de toile.
Ma lampe, clignotante ainsi qu'un œil humain
Dont la veille ou les pleurs ont gonflé la paupière,
S'affaiblit, et ma plume échappe de ma main.
O Sommeil! c'est vers toi que monte ma prière.
Viens, toi, presque aussi doux qu'est la très douce Mort,
Sur mon front incliné pose ton doigt de pierre.
Que la Nature est tendre à l'homme qui s'endort!
Quand elle eut du néant tiré nos pauvres âmes,
Elle fit le sommeil, prise par un remord.
Le sommeil... le repos, le nirvanâ des brahmes,
Instants qui sont pour nous, par leur oubli profond,
Les meilleurs après ceux dans lesquels nous aimâmes.
Matière inerte et sourde en qui tout se confond,
Toi qui n'as pas de chair douloureuse et subtile,
Quand tu m'ouvres ton sein, j'y descends jusqu'au fond;
Je dors, je t'appartiens, la douleur inutile
Est vaincue, et mon cœur est plus indifférent
Que n'est le marbre dur que le sculpteur mutile.
Ce bonheur passager que le réveil reprend,
Avant-goût du bien-être immense de la tombe,
Devenant éternel, enchante le mourant.
Sommeil, je t'ai prié... Tes bras s'ouvrent... J'y tombe.
Je voudrais, sur les bois tout vibrants de doux cris,
Planer, planer longtemps, puis tout à coup descendre,
Et ravir en son rêve un rossignol surpris,
Sur un nuage gris.
Sur un nuage blanc—blanc comme douce neige—
Je voudrais, au sommet du mont étincelant,
Découvrir l'édel-weiss, qu'un âpre exil protège,
Et l'emporter ensuite, astre frêle et tremblant,
Sur un nuage blanc.
Sur un nuage feu, nef aux ardentes voiles,
Je voudrais—car la fleur des glaciers, c'est trop peu—
Aller glaner là-haut dans le champ des étoiles,
Et choisir la plus fière au ciel immense et bleu,
Sur un nuage feu.
Sur un nuage d'or, éperdu dans sa course,
Je voudrais entraîner d'un invincible essor
Celui que j'aime aux bords où la vie a sa source,
Pour qu'en l'éternité nous nous aimions encor,
Sur un nuage d'or.
Flot d'azur qu'un rayon du ciel peut embraser,
Dans ton sein palpitant tu dois cacher une âme,
Vive, douce pourtant, et prompte à s'apaiser.
Ne dit-on pas: «Changeant comme l'onde et la femme»?
Contre le roc ému la mer vient se briser;
L'écume que, farouche, élève chaque lame,
Sur les fleurs, dans la nuit, descend comme un baiser.
Roulant au flanc des monts, la cascade légère
Semble glisser gaîment sur les lits de fougère;
Le ruisseau chante ou pleure à travers les forêts.
Rien n'a tant de pouvoir et rien n'a tant de charme.
O pure goutte d'eau, qui dira tes attraits?
N'es-tu pas l'Océan?... N'es-tu pas une larme?
Dans l'éclat du jour ou l'ombre des soirs,
J'aime errer sans trêve.
Parmi les rameaux emplis de chansons
Le vent passe et meurt en vagues frissons:
Je poursuis mon rêve.
Sous les taillis clairs où midi s'endort
Le soleil, jetant ses paillettes d'or,
Se brise en fusées;
Et les moucherons dans ce flamboiement,
Ivres de chaleur, font un tournoiement
D'ailes irisées.
Mille insectes fins se cachent, tapis
Parmi les plis roux des anciens tapis
De frondaisons sèches;
Car les étés morts, sous de bruns linceuls,
Dorment à jamais, oubliés et seuls,
Dans les sentes fraîches.
Sur le pied rugueux des chênes touffus
La mousse répand un reflet diffus
De pâle émeraude;
Et sur quelques fleurs, par vols lents et lourds,
L'incertain bourdon au corps de velours
Étincelle et rôde.
Dans les flots mouvants des sommets houleux
Glissent par lambeaux les firmaments bleus,
Comme des prunelles;
Et, lorsque tout bruit paraît s'endormir,
Même en ce silence on entend gémir
Des voix solennelles.
Dans les bras tordus des ronciers fleuris
La vive araignée au bout d'un fil gris
Voltige et circule;
Mon esprit, lassé par de longs combats,
S'attendrit à suivre en ses vains ébats
L'être minuscule.
Alors, sans regret, sans peur, sans dessein,
J'écoute frémir, paisible en mon sein,
L'éternelle vie;
L'immense Nature, au fond des forêts,
Laisse pénétrer en ses doux secrets
Mon âme ravie.
Atome pensif, j'entends l'Infini
Murmurer en moi son hymne béni
Par la voix des choses.
Mon cœur n'a qu'un jour, mais dans son néant
Vient se refléter l'univers géant,
Des soleils aux roses.
Sous les arbres verts, sous les arbres noirs,
Dans l'éclat du jour ou l'ombre des soirs,
J'aime errer sans trêve.
Parmi les rameaux emplis de chansons
Le vent passe et meurt en vagues frissons:
Je poursuis mon rêve.
Qu'importe l'avenir? Vivrai-je encor demain?
Pour mon cœur isolé que peut l'humaine foule?
Et qu'importe l'espace à mon étroit chemin?
Multitude des jours, multitude des nombres,
O cieux illimités! ô race des mortels!
Je tends vers vous les mains vainement, pâles ombres...
Les songes de mes nuits plus que vous sont réels.
Vous n'êtes, pour mes yeux que vous trompez sans trêve,
Pour mon âme impuissante à vous jamais saisir,
Que le fuyant reflet d'un impossible rêve
Et que l'âpre aiguillon d'un éternel désir.
Devant le flot mouvant des heures et des choses,
Près du fleuve infini que sondent nos regards
Et qui roule la vie en ses métamorphoses,
Tantales altérés, nous nous penchons hagards.
Nous ne possédons rien de ces biens sans mesure,
Pas même un jour certain dans l'abîme des jours;
Tout nous est étranger dans l'immense Nature,
Tout, jusqu'au cœur chéri qui s'ouvre à nos amours.
Murés dans le présent, prisonniers dans notre être,
Ce que nous possédons des trésors poursuivis
C'est le mirage seul que nous fait apparaître
La seconde éphémère où nous disons: «Je vis.»
La vision d'hier est à jamais éteinte;
Qui sait sur quoi, demain, nos yeux seront ouverts?...
Notre âme, renaissante à chaque heure qui tinte,
N'est qu'un frisson furtif où frémit l'univers.

Les solennelles voix de l'immense univers,
Vous m'avez demandé, pour vous railler sans doute,
De vous parler en vers.
Vous connaissez pourtant les paroles de femme,
Léger souffle effleurant votre lèvre tout bas:
Votre cœur s'y enivre un instant, mais votre âme
Les juge, et n'y croit pas.
Vous aimez le doux rythme et la lente harmonie;
Vous trouverez peut-être un plaisir tout nouveau
A voir ainsi monter la tendresse infinie
Du cœur jusqu'au cerveau.
Tous ces balbutiements de bouches frémissantes,
Tous ces aveux d'amour que vous avez comptés,
Ils vous lasseront moins lorsqu'en rimes puissantes
Ils seront racontés.
Eh bien, écoute-les... Ils sont toujours les mêmes.
Qu'importe que je sache un art qui peut charmer,
Puisque vous demandez en vos doutes suprêmes
Si je sais mieux aimer?
Qu'importe que j'emprunte une langue divine,
Si vous ne voyez pas sous les mots précieux
Ces choses que, sans voix, on lit et l'on devine
Dans un éclair des yeux?
Ainsi vous connaîtrez, en parcourant le monde,
Tous les obscurs chemins par où l'homme a marché,
Et mon cœur qui se montre, ô misère profonde!
Vous restera caché.
Vous irez retrouver dans son ombre farouche,
Avec son sens perdu, l'hiéroglyphe sacré;
Mais en vous rappelant quelque mot de ma bouche
Vous direz: «Est-ce vrai?»
Vous interrogerez les colonnes, les dômes,
Les piliers de granit du temple au vaste front,
Et vous les croirez, eux, ces muets, ces fantômes,
Lorsqu'ils vous répondront.
Mais si, malgré les dieux à la morne attitude,
Qui de leurs peuples morts nous gardent chaque trait,
Devant vos yeux lassés, dans votre solitude,
Mon visage apparaît,
Vous aurez aussitôt ce sceptique sourire,
Que je comprends trop bien pour vouloir m'en blesser.
J'en souffre, et je vous plains... Tout ce que je puis dire
Ne saurait l'effacer.
Voilà bien, voilà bien la douleur éternelle,
L'angoisse de l'amour et l'effroyable émoi
Où l'on crie, en dépit de l'étreinte charnelle:
«Cet être est-il à moi?...»
Pourtant les mots sont doux; quoique vains, ils vous plaisent
Comme un chant dans les bois ou la plainte des mers.
Sans vous guérir, qu'au moins les miens parfois apaisent
Vos souvenirs amers.
Quand vous ignoreriez combien leur source est vive,
Qu'importe!... Je me trouve heureuse simplement
De penser que leur note attendrie et plaintive
Vous délasse un moment.
La vie en tout mêlée à la mort chaque jour.
Mais dans ces vérités mon cœur, qui s'y confie,
Ne voit que notre amour.
Je songe—devenue entre vos mains savante—
A ces temps si prochains où chacun de nos corps,
Achevant son destin de matière vivante,
Perdra ses fins ressorts.
Je songe à l'infini des formes successives
Qu'ensuite vêtira chaque atome éternel,
Dans l'avenir, rendu par les âmes pensives
A l'élément charnel.
Peut-être—car les jeux de l'immense Nature
Suivent, m'avez-vous dit, une inflexible loi—
Ce qui fut Vous aura quelque étrange aventure
Avec ce qui fut Moi.
De votre être effacé peut-être une parcelle
Rencontrera, là-bas, là-haut, je ne sais où,
Un débris de mon cœur, qui maintenant recèle
Son amour tendre et fou.
Peut-être—c'est, je crois, ce qu'apprend la chimie—
Quelque combinaison étroite surviendra:
Un peu de votre cœur au cœur de votre amie
Tout à coup se fondra.
Et la fatalité des effets et des causes,
Bien que cruelle et dure et froide, aura rempli
Ce que serments, aveux, promesses, douces choses,
N'avaient point accompli.
Les pieds encor poudreux du chemin parcouru,
Sceptique, et détrompé par votre expérience,
Vous m'êtes apparu,
Je me suis dit, moi, faible et l'âme si meurtrie:
«Il connaît des secrets pleins d'âpre volupté,
Pouvant donner au cœur qui sanglote et qui prie
L'impassibilité.
«Il sait, lui qui fraya sa route inexplorée,
A travers des tombeaux, vers les siècles lointains,
La valeur véritable et l'essence ignorée
Des bonheurs incertains.
«Sans doute il guérira l'espoir qui reste encore,
Et qui fait tant souffrir, étant toujours déçu,
L'espoir, mal immortel, qui charme et qui dévore
Le sein qui l'a conçu.
«La résignation et l'ardeur de connaître,
Le spectacle évoqué des jours évanouis,
Ont calmé doucement dans le fond de son être
Les désirs inouïs.
«Il sonde le passé. Les vieilles pyramides
Ne sont plus à ses yeux que des témoins d'hier.
Il voit à ses débuts sauvages et stupides
L'homme aujourd'hui si fier.
«De nos illusions, de la folle espérance,
Il a vu commencer et finir le pouvoir:
Règne court, séparant de l'heureuse ignorance
Le tranquille savoir.
«Dès qu'elle eut la douleur de penser, l'âme humaine
Par un songe divin s'est voulu consoler,
Mais ce songe, en la route où son destin la mène,
Déjà va s'envoler.»
Ayant vu tout cela, ces choses que l'Histoire
Cache sous sa sévère et froide majesté,
Elle qui d'un état fragile et transitoire
Fait une éternité;
Ayant vu cet abîme et sondé ces problèmes,
Vous deviez rapporter, chercheur audacieux,
Le dernier mot voilé par tant d'obscurs emblèmes
Sur terre et dans les cieux.
Et moi qui vous admire, et moi qui vous envie,
J'ai levé sur vos yeux mes yeux mouillés de pleurs,
Pour apprendre de vous à dérober ma vie
Aux stériles douleurs.
Je vous ai demandé: «Par quoi faut-il sur terre,
Par quoi faut-il emplir nos cœurs, qui n'ont qu'un jour?»
Vous m'avez répondu, vous le savant austère:
«Emplissez-les d'amour.»
Quoi! l'immense univers n'a point comblé le vôtre?
Parmi tout ce qui naît et tout ce qui périt,
Quoi! nul bien ne valait un autre cœur, un autre
Qui pour vous seul s'ouvrît?
Vous m'avez révélé ce mystère suprême,
Vous m'avez dit: «Le monde et le ciel éclatant
Sont un gouffre effroyable et vide à moins qu'on n'aime,
N'aimât-on qu'un instant.
«De l'homme disparu chaque infime vestige
Dévoilerait vraiment trop d'atroce douleur,
Si l'amour n'entr'ouvrait sur sa cendre, ô prodige!
Son immortelle fleur.»
Partout il a germé, l'amour qui nous enivre,
Vous l'avez vu partout où votre esprit plongea,
Et vous venez me dire: «Il faut aimer pour vivre.»
Je le savais déjà.
O mon cœur, réponds, toi! Pourquoi donc l'ai-je aimé?
Tu sortais cependant d'un bien affreux martyre;
Je te croyais fermé.
Ton sang avait coulé bien longtemps goutte à goutte;
Des pleurs, des pleurs cruels avaient terni mes yeux.
Ah! s'il avait souffert, je comprendrais sans doute,
Mais il semblait heureux.
Ce n'est pas la douleur qui joignit nos deux âmes,
On ne la lisait pas dans ses regards de feu;
Il était fier et fort, et les chagrins des femmes
L'irritaient quelque peu.
L'amour, pour lui, n'est pas le dieu qui nous tourmente:
C'est un enfant joyeux jouant sur son chemin;
Il se penche, et lui rit... C'est une fleur charmante
Qui se fane en sa main.
Une chose pourtant lui paraissait amère,
C'est que la fleur d'un jour, détruite sans pitié,
Portât si rarement sur sa tige éphémère
Le fruit de l'amitié.
Et j'ai cru deviner que dans la solitude
Le plus hardi marcheur à la fin devient las:
Ce n'était point l'amour, mais la sollicitude
Qui manquait à ses pas.
L'amour... il en savait l'ivresse ardente et brève,
Le secret égoïsme et les transports jaloux;
Peut-être, malgré lui, nourrissait-il un rêve
Plus profond et plus doux.
Lorsque je pressentis cette vague détresse
Dans un être si fort et si maître de soi,
J'eus l'éblouissement d'une immense tendresse
Montant soudain en moi.
Présenter à sa soif la coupe intarissable,
Être son ombre fraîche et son moment d'oubli,
Voir en cette âme haute avec ce grain de sable
L'équilibre établi;
Être mieux que sa sœur et mieux que sa maîtresse;
Être le souvenir qu'il berce en souriant
Quand luira sur son front l'éclatante tristesse
Du ciel de l'Orient:
Voilà l'ambition douce et passionnée
Qu'ont fait naître en mon cœur ses beaux yeux inconstants.
Et lorsque de l'aimer je me suis étonnée,
Il n'en était plus temps.
A ce plan gigantesque en votre esprit conçu:
Retracer pas à pas le chemin que le monde
Poursuit à son insu;
Cet unique chemin où, dans l'ombre éternelle,
Tout en semblant errer, marche le genre humain;
Où jadis de ses dieux la bonté paternelle
Le guidait par la main.
Vous contemplez partout les forces impassibles;
Sans pouvoir présumer leurs effets à venir,
Sans décider non plus sur leurs causes possibles
Et sans les définir,
Vous voulez seulement constater leur empire,
Dire où leur bras de fer a dirigé nos pas.
Si pour d'autres Demain sera meilleur ou pire,
Vous ne le cherchez pas.
Et Demain toutefois, recueillant vos idées,
En illuminera le Passé, noir décor;
Elles iront ainsi, par le temps fécondées,
Grandissantes encor.
Elles ajouteront leur pierre à l'édifice
Dont vous étudiez, pensif, les fondements:
Tour dont le sang des cœurs, les pleurs du sacrifice
Forment les durs ciments,
Et qui monte toujours, Babel inébranlable,
Et qu'on n'augmentera qu'en faisant comme vous,
En sondant les secrets du passé formidable,
Car lui seul est à nous.
Moi, qui de ces lueurs reste tout éblouie,
Et qui toujours échappe à la réalité,
J'eus un songe embrassant—vision inouïe!—
La vague immensité.
Je vis l'effort constant de l'ardente Nature,
A chaque illusion accordant son tribut
Et suivant jusqu'au bout l'éternelle aventure,
Toucher enfin le but.
De progrès en progrès se cherchant elle-même,
Grâce à des millions de siècles entassés
La matière unirait dans un être suprême
Ses pouvoirs dispersés.
Elle aurait ce jour-là la pleine conscience
De son essence propre et de ses propres lois;
Toute évolution et toute expérience
Cesseraient à la fois.
Les temps seraient remplis. La puissance infinie
N'étant qu'un attribut de l'absolu savoir,
Il paraîtrait enfin, ce Dieu que l'esprit nie,
Que le cœur voudrait voir.
Ainsi s'expliquerait le tourment indicible,
Le désir implacable et de tous les instants
Qui sur l'âpre chemin du bonheur impossible
Nous traîne haletants.
Ce rêve d'idéal, d'amour et de lumière,
Qui commence à la bête et qui finit à Dieu,
Nous charme, nous, chétifs, à la forme première
Disant à peine adieu.
Mais tandis qu'autrefois, par une erreur grossière,
Nous placions hors de nous la divine grandeur,
Nous savons aujourd'hui que de notre poussière
Doit surgir sa splendeur.
Nous la portons en nous, comme l'infime atome
En germe recélait l'esprit qui resplendit.
Quoi! déjà dans nos seins le sublime fantôme
Se dégage et grandit.
Triomphe, ivresse, espoir où notre orgueil s'abreuve!
Hélas! qu'il nous soit doux au moins de le penser,
Car la loi qui nous fit, gauche et fragile épreuve,
Va nous recommencer.
Mais peut-être,—ô mystère! ô synthèse des choses!
Enfantement brutal, horrible, essentiel,
Dont tout souffre, l'insecte en ses métamorphoses
Et l'astre énorme au ciel,—
Peut-être, dans l'immense et finale harmonie,
Rien ne s'étant perdu, nos maux, nos passions
Feront plus de clarté que la gloire infinie
Des constellations.
Et puisque, élaborant un Dieu, créant un être
Qui réunisse en soi ses milliers d'éléments,
La Force unique doit avant tout se connaître
En tous ses changements,
Vous, dont l'œil calme a lu dans le temps et l'espace,
Qui voulez, pressentant cette suprême loi,
Dire à l'humanité qui se hâte et qui passe:
«Attends, regarde-toi!»
Vous êtes en avant de la foule frivole,
Vous avez fait un pas vers l'accomplissement,
Et votre voix tranquille a mis une parole
Dans notre bégaiement.
Rien, disiez-vous, n'est vrai qu'aimer.
Hélas! l'attrait d'une œuvre austère
Semble aujourd'hui seul vous charmer.
Vous allez, sondant les vieux mondes,
Chercher des vérités profondes
Parmi leurs poussières fécondes
Que vous aurez su ranimer.
L'ardeur de savoir vous entraîne,
L'amour n'a pu vous retenir,
Et mon bonheur, éclos à peine,
Comme un beau songe a dû finir.
Mais, sous les étoiles sans nombre,
Dans vos longs soirs sur la mer sombre,
Que poursuit donc votre œil, dans l'ombre?...
Est-ce un rêve, ou mon souvenir?
L'Inde éclatante et formidable
Vous livre ses secrets de feu;
Sous le symbole redoutable
Vous évoquez l'âme et le dieu.
Mais votre regard qui se lasse
Se lève, et se perd dans l'espace...
Est-ce mon image qui passe
Alors, douce, au fond du ciel bleu?
L'exil est lourd, la route est dure,
Vous affrontez bien des combats;
Quelque dangereuse aventure
Vient peut-être entraver vos pas.
Mais une voix tendre et touchante
Vous rend l'espoir et vous enchante...
Est-ce alors mon amour qui chante
Au fond de votre cœur, tout bas?
De l'hiver qui déjà frissonne sur nos fronts
Et des lugubres soirs tombant brusques et prompts.
Le soleil, qui s'enfuit dans sa morne vitesse,
Ouvre au sein des brouillards des trous sanglants et ronds.
Les peupliers jaunis et les grands ormes chauves
Se dressent sur un ciel d'ardoise au dur reflet.
Leurs fronts touffus, vers qui le passereau volait,
Ne sont plus qu'un horrible amas de feuilles fauves
Où le vent furieux joue ainsi qu'il lui plaît.
Les sentiers sont jonchés de leurs dépouilles sèches,
Qui sous le pied distrait grincent sinistrement;
Nul n'entend sans frémir leur sourd gémissement.
Les livides matins, voilés de brumes fraîches,
Dans les cieux, à regret, montent tardivement.
Nous suivons le vol fou des nuages rapides.
Mais vous, vers l'équateur avançant chaque jour,
Vous voyez s'élever de la mer, tour à tour,
Des constellations nouvelles et splendides,
Promontoires de flamme au scintillant contour.
Vous saluez, tandis que nos chairs se hérissent
De douleur et de froid, un éternel été.
Vers la rive immuable où vous êtes porté
L'espoir tourne vos yeux. Les bonheurs qui périssent,
Seuls, captivent encor notre cœur attristé.
Nous pensons au passé durant le crépuscule,
Mais votre âme éblouie embrasse l'avenir.
Nous nous disons: «Ceci n'a pu le retenir...»
Vous, devant l'horizon qui sans cesse recule,
Vous songez que l'exil est court et doit finir.
Car la Nature ainsi dirige nos pensées;
Nul ne soustrait son cœur à l'effet souverain.
Que le ciel soit d'azur ou bien qu'il soit d'airain,
Que les étoiles d'or y brillent balancées,
Notre rêve aussitôt devient sombre ou serein.
Notre être intérieur, qu'un aspect calme ou blesse,
S'offre comme un sensible et frémissant miroir
Où l'énorme univers se penche pour se voir.
L'Infini redoutable emplit notre faiblesse;
Son ombre y devient joie exquise ou désespoir.
De son reflet changeant se forment nos idées,
Ses mystères profonds ont créé nos douleurs,
Ses océans amers semblent des flots de pleurs;
Nos âmes, par des yeux pleins d'amour obsédées,
Dans leur gouffre attirant retrouvent ses couleurs.
Sphinx éternel et beau dont le sourire enivre,
Il siège en sa puissance au fond même du Moi.
Quand mon sein se soulève et palpite d'émoi,
Et que j'y veux descendre et me regarder vivre,
C'est lui que j'y découvre en reculant d'effroi.
Où suis-je?... Il me reprend et m'enlève à moi-même.
Ce que je fus hier, le serai-je demain?
Dans quel creuset brûlant me jettera sa main?
Je voudrais bien savoir pourquoi je souffre ou j'aime,
Je voudrais à mon gré poursuivre mon chemin.
Je ne le saurai pas, je marche à l'aventure:
Tout l'univers circule en mes veines de feu,
Dans mes moindres frissons ses Forces sont en jeu;
J'accomplis les destins de l'immense Nature
Aussi fatalement que l'atome et que Dieu.
Moi qu'emplit la pitié, je me sais implacable:
Implacable aussi bien pour me laisser souffrir
Que pour briser des cœurs que j'ai voulu chérir.
L'affreuse vision du mal inévitable
M'épouvante, et parfois je souhaite mourir.
Car je redeviendrais une poussière inerte,
Sans nerfs, sans yeux, sans cœur, sans amour et sans soins;
Insensible instrument, j'ignorerais du moins
L'horreur de consommer jour après jour ma perte;
Les maux que je ferais auraient d'autres témoins.
Et vous, que berce au loin la mer étincelante,
Quand le soleil rougit les vagues de cristal,
Que vous dit la splendeur du monde oriental?
Nul désir n'émeut-il votre âme vigilante?
Vous courbez-vous sans plainte au joug du sort fatal?
Pénétrer le secret des Forces souveraines
Vous suffit-il?... D'un œil tranquille et d'un cœur fier,
Les verriez-vous étreindre et broyer votre chair?
Ah! du fond du néant j'aime insulter ces reines,
Et pleurer longuement sur tout ce qui m'est cher.
Un jour vous reverrez notre ciel pâle et doux;
Mais l'adieu qu'en partant me laissa votre bouche,
Vous en souviendrez-vous?
Au fond de votre cœur et de votre mémoire
Ce tendre mot d'adieu, faible écho du passé,
Tout un monde inconnu surgissant dans sa gloire
L'aura-t-il effacé?
Vous en souviendrez-vous?... Sur cette rive étrange,
A l'ombre des palais, au bord du lac sacré,
Parmi les temples d'or baignés des flots du Gange,
L'avez-vous murmuré?
L'avez-vous dit parfois, descendant en vous-même,
Non plus prêt à me fuir, non plus comme un adieu,
Mais sûr de votre cœur et dans l'ardeur suprême
D'un solennel aveu?
L'avez-vous dit ainsi loin de moi?... L'Inde antique
N'a-t-elle point, jalouse, épié le secret
Qui, devant sa beauté rayonnante et mystique,
Rendait votre œil distrait?
Oh! pour vous quelquefois j'ai peur de sa vengeance:
Sur la jungle fiévreuse erre un souffle de mort,
Et le tigre royal rôde avec diligence
Dès que l'homme s'endort.
Oh! j'ai peur... Gardez-vous, s'il vous souvient encor,
Lorsque vous me quittiez, de votre dernier mot,
Dans les bois, sur le fleuve, ou près du roc sonore,
De le dire tout haut.
Car la nature altière, imposante et terrible
Que vous étudiez, connaît bien son dessein:
L'homme, vile poussière, est passé par son crible
Et se perd dans son sein.
Rien pour elle n'est moins qu'un être et qu'une vie;
L'Inde veut l'âme esclave et joue avec la chair;
En prononçant mon nom, craignez qu'elle n'envie
Un souvenir trop cher.
C'est moi qui redirai, lorsque mon cœur se serre
Et tremble pour vos jours auxquels il est lié,
Ce mot magique et doux, ce mot qui fut sincère,
Mais peut être oublié.
Et quand vous reviendrez, s'il n'est pas sur vos lèvres,
Je n'en parlerai point, nous resterons amis.
Vous voulez plus encor que l'amour et ses fièvres,
Et je vous l'ai promis.
Tandis que je songeais à vos futurs dangers,
Un doute vous saisit touchant mon cœur de femme.
Parfois les doux serments deviennent mensongers.
Vous prîtes un collier que porta votre mère:
Des perles, en trois rangs chatoyants et légers.
«Si vous n'avez pour moi qu'un amour éphémère,»
Dites-vous, «si l'absence en vous sème l'oubli,
Évitons au retour toute parole amère.
«Si le rêve d'un jour doit être enseveli,
Sans un mot rendez-moi ces perles, et ma lèvre
Ne protestera point contre un fait accompli.
«Une mâle douleur n'a pas de plainte mièvre.
Puisse un jour ce collier, chère âme, à votre cou,
M'annoncer le bonheur dont mon exil me sèvre.»
Hélas! et de vos mains je reçus le bijou.
Vous aimiez ma tendresse et vous fuyiez loin d'elle:
Tant l'homme en ses désirs est inconstant et fou.
Mais dans mon triste cœur je la sens éternelle.
Qu'on mette en mon cercueil vos perles, si je meurs!
Jusqu'au fond du tombeau je vous serai fidèle.
Mes yeux en ce moment les arrosent de pleurs.
Tandis que loin de moi vous risquez votre vie,
Un songe a, cette nuit, ravivé mes douleurs.
Enfin vous reveniez... La gloire qu'on envie
Couronnait votre front, pâli par vos travaux;
Je m'avançais vers vous, interdite et ravie.
Plus sacré qu'un fétiche adoré des dévots,
Sur mon sein le collier, éclatant témoignage,
A notre ancien amour marquait des jours nouveaux.
Et moi je le touchais, le tendre et noble gage;
Vers lui d'un geste fier j'appelais vos regards:
Vous comprendriez bien son mystique langage.
Horreur! vos yeux si beaux se dilatent, hagards...
Entre mes doigts tremblants se rompt la fine chaîne,
Et les perles soudain roulent de toutes parts.
Alors je m'éveillai dans une étrange peine.
C'était un songe vain... Mais quoi! j'entends toujours
Le bruit sinistre et doux du collier qui s'égrène.
Il est là, ruisselant sur l'écrin de velours,
Intact et pur ainsi qu'en moi la foi jurée;
Les seuls joyaux épars sont mes pleurs lents et lourds.
Ma douleur à sa cause est bien peu mesurée,
Mais l'amour rend crédule au présage trompeur
L'âme la plus hautaine et la plus assurée...
Et, malgré ma raison, ce rêve me fait peur.
Dont le flux lourd et lent monte jour après jour,
Avait pu dans mon cœur effacer jusqu'à l'ombre
De mon divin amour.
La vie est-elle donc, ami, si magnifique
Que j'ose me jouer de son meilleur trésor,
Et compter que demain sa bonté pacifique
Me le rendrait encor?
Hélas! n'est-elle pas si durement amère
Que nous restons tremblants du bonheur effleuré:
Il ne nous apparaît, dans une heure éphémère,
Que pour être pleuré.
Quand nous l'avons touché de nos mains qui frémissent,
Pour qu'il demeure, en vain nous prierions les dieux sourds
Nos cœurs l'ont reconnu, nos cœurs s'épanouissent...
Puis saignent pour toujours.
Et moi qui l'ai saisi, ce bonheur que l'on rêve,
Et moi qui l'ai pressé sur mon sein palpitant,
Je précipiterais sa course déjà brève
Au néant qui l'attend!
Moi qui crains tant pour lui, le sachant périssable,
Sur lui j'appellerais le souffle de l'oubli,
Semblable au vent de mer qui recouvre de sable
Un nom enseveli!
J'oublierais!... Mais quel bien me resterait sur terre,
Puisque vous êtes loin, puisque tout doit finir,
Puisque aujourd'hui déjà mon âme solitaire
N'a plus qu'un souvenir.
J'en réveille l'ivresse et frémis, car je songe
Que ce cher souvenir, seul, n'est point incertain;
Gardé par le Passé, dans lequel mon œil plonge,
Il échappe au destin.
Mais l'espoir, qui vous suit sur votre longue route,
Qui vous ramène à moi tel qu'au soir des adieux,
Dépend de l'Avenir, dont j'épie avec doute
Le mot mystérieux.
C'est pourquoi j'éternise une heure passagère,
Où mon cœur doucement a cru vous deviner;
J'y vivrai jusqu'au jour où votre voix si chère
Viendra m'en détourner.
Les flots étaient changés en cristaux clairs et durs,
Et nos cœurs se taisaient, pleins de doutes obscurs,
Dans les limpides soirs aux tristesses sans bornes,
Quand la lune montait, lente, au fond des cieux purs.
Et ce matin voici comme une molle haleine
Flottante autour de nous dans les airs attiédis;
L'eau ruisselle en torrents sur les prés reverdis,
Et la forêt, de vie et de voix toute pleine,
Semble tendre au doux vent ses grands bras engourdis.
C'est un moment rempli d'ineffable surprise.
Nous savions que l'hiver devait s'enfuir un jour,
Pourtant nous éprouvons, dans le soudain retour
De ce baiser d'en haut, de cette chaude brise,
Comme l'émoi causé par un naissant amour.
Pour moi, j'ai mieux encor que cette vague ivresse;
Je vois dans le printemps la fin de votre exil.
Je ne murmure plus: «Hélas! reviendra-t-il?»
Le souffle des beaux jours a chassé ma détresse,
Je respire l'espoir en son parfum subtil.
Oh! oui, vous reviendrez... Tout l'annonce et le chante.
Dans mes songes déjà je crois voir sur la mer,
La proue à l'occident, filer un grand steamer.
Il sera, ce retour dont l'image m'enchante,
Doux autant qu'autrefois le départ fut amer.
Venez... Nous reprendrons nos longues causeries;
Dans nos cœurs éprouvés nous lirons jusqu'au fond.
Au-dessus des humains et du vain bruit qu'ils font,
Quelle extase ravit deux âmes attendries
Lorsqu'une intimité sublime les confond!
L'amour nous a conduits par de mystiques voies.
Vous l'accusiez un jour d'avoir trop tard uni
Nos cœurs, où plus d'un rêve, hélas! s'était terni;
Mais il nous préparait d'inconcevables joies,
Car il nous mûrissait pour le moment béni.
Il nous fallait d'abord devenir forts et graves,
Avoir beaucoup lutté, cherché, compris, souffert,
Vu l'abîme des temps sous nos pas entr'ouvert,
Et dominé le sort tranquillement, en braves,
Pour que le vrai bonheur enfin nous fût offert.
Ce que nous nous dirons par les douces soirées,
Dans le bruit de la ville ou le repos des bois,
Sera tendre et profond, mais austère parfois,
Car nos mains ont touché bien des choses sacrées;
L'angoisse du néant fera trembler nos voix.
Mais un arome fin monte du sol humide
Où la neige d'hier a doucement fondu.
C'est le printemps, ami... Vous êtes attendu.
Un petit passereau module un chant timide,
Puis s'étonne, et soudain vole tout éperdu.
Oh! combien je jouis de ces métamorphoses!
Chacune tour à tour va grandir mon espoir.
Des fleurs!... Il va s'ouvrir des fleurs sur le sol noir!
Venez... Il ne faut pas faire mentir les choses,
Et les arbres m'ont dit que je vais vous revoir.
Où mon cœur vous suivait bien loin sous d'autres cieux.
Vous êtes près de moi; mon regard qui se lève
Va rencontrer vos yeux.
Vos yeux... devant lesquels ont passé des merveilles,
Et qui, las de sonder pourtant et de savoir,
Après les jours brûlants, durant les sombres veilles,
Se fermaient pour me voir.
Vos yeux changeants... où j'aime à surprendre votre âme
Tantôt douce, et croyante, et tendre, et se livrant,
Tantôt sceptique au point que leur cruelle flamme
Me brûle en m'effleurant.
Votre amour me ravit, comme aussi votre doute:
En vain vous proclamez un fatalisme obscur,
Je saurai malgré vous placer sur votre route
Un bonheur calme et sûr.
Je connais le secret de la détresse affreuse
Dont le plus fort se sent tôt ou tard accablé;
Tout au fond de notre être un abîme se creuse
Qui jamais n'est comblé.
Et plus le cœur est grand, plus le vide est immense.
Sur votre cœur, ami, je me penche en tremblant...
L'espoir de le remplir me saisit,—ô démence!—
Enchanteur et troublant.
Je ne puis qu'apaiser l'âpre mal qui le blesse,
Tromper, jour après jour, son éternel désir,
Puisque le bien suprême est, pour notre faiblesse,
Impossible à saisir.
Mais j'ai rêvé du moins d'accomplir cette tâche.
Je vous consolerai de l'immortel ennui.
Mon amour à vos yeux voilera sans relâche
Le néant, même en lui.
Vous ne me direz plus qu'il est court et fragile,
Que la satiété mène aux mornes adieux.
Par lui vous garderez sous votre front d'argile
L'esprit serein des dieux.
Au bout de ce chemin rude et plein de vertige
Que vous suivez, marchant vers un but inouï,
Beau lis, il fleurira, mystique, sur sa tige
Toujours épanoui.
Vous n'éprouverez plus l'angoisse des abîmes
Où, tout en frémissant, plonge votre raison,
Quand vous le reverrez, plus riant, sur les cimes,
Après chaque saison.
Vous oublierez l'horreur de notre destin sombre,
—Naître pour vivre seuls et mourir tout entiers,—
Parce que l'humble fleur dessinera son ombre,
Le soir, sur vos sentiers.
Et comme elle a conçu de folles jalousies,
Son calice profond, dans l'air des hauts sommets,
Changera ses parfums suivant vos fantaisies,
Sans s'épuiser jamais.
Afin que vous goûtiez toute joie auprès d'elle:
Car son âme de fleur a conçu le dessein
De vous offrir ainsi, pour vous garder fidèle,
Mille amours dans son sein.
Où vous avez erré si longtemps loin de moi;
Votre amour et vos soins, qui m'y servent de guides,
M'en ont ôté l'effroi.
J'ai plongé sans péril en leur puissant mystère.
Vous seul avez porté le poids des lourds travaux;
Vous seul avez bravé, dans votre exil austère,
Mille dangers nouveaux.
Moi, je jouis en paix de votre œuvre hardie.
O voyageur aux mains pleines d'illusions!
La sphère où je circule est par vous agrandie,
Car j'ai vos visions.
Si vous avez vécu dans les siècles antiques
Que les temples déserts vous semblaient contenir,
Moi, je hante aujourd'hui tous ces hautains portiques
Dans votre souvenir.
L'Inde s'est tout entière empreinte en vos pensées,
Et, comme j'y sais lire, ainsi je l'entrevois.
Sa présente misère et ses splendeurs passées
Me frappent à la fois.
Comme vous, ce que j'aime en elle, triste esclave,
Ce n'est pas sa beauté, qu'un maître viola,
Ni ses villes d'or fin que l'eau du Gange lave,
Que l'Occident vola.
C'est l'idée immortelle, invincible, insondable,
Qui jadis y fleurit, digne d'un tel décor,
Qui, dans le sein muet du désert formidable,
S'épanouit encor;
Idée où la science, en nos sombres contrées,
Sans poétique flamme, arrive pas à pas,
Mais qui brille et se vêt de ses grâces sacrées
Au soleil de là-bas.
C'est l'évolution, l'éternité des choses,
L'Absolu qui se crée, en des efforts constants,
Par les combinaisons et les métamorphoses
Des formes dans le temps.
C'est notre être perdant au tombeau sa substance,
Mais s'immortalisant par tout ce qu'il aima,
Effet qui devient cause après son existence,
Mystérieux Karma [D].
Quoi! ne suffit-il pas à notre ardeur amère,
Au sein du radieux et vivant tourbillon,
De laisser après nous de notre œuvre éphémère
Un éternel sillon?
Quoi! ne suffit-il pas au besoin de justice
Qu'un mot de notre lèvre, aussitôt oublié,
Pour le bien ou le mal à jamais retentisse,
Fécond, multiplié?
A notre lâche cœur qui cherche un vain salaire,
Que peindraient de plus grand ses vœux intéressés?
Et pour nous arrêter aux heures de colère
N'est-ce donc point assez?
L'Inde le proclama pendant trois mille années.
Notre aride science à peine le pressent.
Ces hautes vérités, vous les vîtes ornées
D'un cadre éblouissant.
Elles apparaissaient pour vous sous les symboles,
Parmi les dieux pensifs qui chargent les piliers,
Des assises du temple aux arceaux des coupoles
Surgissant par milliers.
Et vous les écoutiez, dans cette nuit sublime
Où la lune, versant sa limpide clarté,
Éclairait pour vous seul, comme au fond d'un abîme,
Une morte cité [E].
Je revois avec vous ces scènes inouïes,
Les monstrueux chevaux le long des murs dressés,
Les merveilles de l'art partout épanouies
En rêves insensés.
Parlez... Il est meilleur d'aimer que de connaître:
Ces deux bonheurs pour moi sont en vous réunis.
L'univers ne m'est rien s'il n'enferme en votre être
Ses secrets infinis.
J'écrivis la boutade amère que voici.
Mon âme, où vous lisez, toujours vous intéresse,
Et des grands vers charmeurs vous aimez la caresse.
Sans trop hocher la tête écoutez donc ceci:
Le verbe—notre orgueil—nous égare et nous leurre;
C'est dans un jour maudit qu'il nous fut révélé.
Le cœur n'a pas de mots: il chante ou bien il pleure,
Il vibre pour jamais d'un soupir qui l'effleure.
Hélas! depuis Babel nous avons trop parlé.
Nous avons gravement prononcé des syllabes
Qui troublaient nos cerveaux et signifiaient peu;
En caractères grecs, égyptiens, arabes,
Enfermant l'infini, comme nos astrolabes
En des chiffres crochus enferment le ciel bleu.
Nous avons profané dans nos langues vulgaires
Le secret de notre être, inexpressible et doux,
Ce secret que sans doute on a compris naguères
Lorsque, innocent encor de ses premières guerres,
L'homme sur son champ noir menait ses grands bœufs roux.
Le champ fumait d'amour sous l'aube rose et tendre;
Un désir éperdu de produire gonflait
La lèvre des sillons, et l'on pouvait entendre
Comme un bruit de baisers s'élever et s'étendre
Sur la cime des bois, lorsque le vent soufflait.
On sentait palpiter la vie intense et neuve
Dans les veines du sol, les antres et les nids.
Le berger, près de l'onde où le troupeau s'abreuve,
Songeait à deux yeux clairs plus limpides qu'un fleuve
Qui le verraient rentrer de ses travaux finis.
Tout germait, tout croissait dans l'aurore dorée,
Tout aimait. Par l'amour triomphant du néant,
La Nature venait de saisir la durée:
La génération, formidable et sacrée,
Livrait au couple humain tout l'avenir béant.
Il nous fallait rester, rudes fils de la terre,
Purs, orgueilleux et nus, et soumis aux destins.
De l'univers profond respectant le mystère,
Il nous fallait, plongés dans un silence austère,
Devant l'immensité courber nos fronts hautains.
Mais nous avons parlé... Nos bouches sacrilèges
Ont fait des créateurs, des genèses, des dieux;
Leur souffle a corrompu nos plus beaux privilèges
Et mêlé d'espoirs faux, d'erreurs, de sortilèges,
Même l'âpre grandeur des éternels adieux.
Notre rôle ici-bas, notre rôle superbe,
N'était-il pas de vivre et, vivant, d'adorer?...
D'adorer le soleil, la femme et le brin d'herbe,
L'enfant, l'étoile d'or, les lis, le flot, la gerbe,
Les cieux—mais sans jamais pourtant les implorer.
Qu'aurions-nous demandé que la bonne Nature
N'eût pas placé déjà sur nos riants chemins?
Quand nos rêves risquaient l'immortelle aventure,
Nous ont-ils peint là-haut, pour l'extase future,
Quelque chose de mieux que nos bonheurs humains?
Non!... Nous devions serrer sur nos chaudes poitrines,
Pendant le jour béni qui nous était prêté,
Nos charnelles amours, fragiles et divines,
Créatrices amours, où seules nos doctrines,
Malgré l'enfantement, ont mis l'impureté.
Puis nous devions mourir, fermer à la lumière
Si douce des matins nos yeux reconnaissants;
D'un suprême regard, plein de candeur première,
Enveloppant les fils, l'épouse et la chaumière,
Tout ce qui fait nos cœurs joyeux et frémissants.
Quel désir, quelle crainte eût ébranlé notre âme?
Quel juge ou quel sauveur pouvions-nous invoquer?
Nos devoirs—ceux qu'un ordre universel proclame—
Ont, pour l'esprit subtil et pour les sens de flamme,
Des charmes si puissants qu'on n'y saurait manquer.
La Nature n'a pas commis à nos morales
Le pouvoir de hâter son auguste action.
Nos gestes sont les siens. Les ombres sépulcrales
N'ont point de rouge enfer au bas de leurs spirales:
L'œuvre utile avec soi porte sa sanction.
Ce qui doit être fait est bon et simple à faire;
De quoi serions-nous donc alors récompensés?
Et puisque la douleur suit le mal qu'on préfère
Et qu'elle est pour nous seuls, par delà cette sphère
Quel courroux frapperait de pauvres insensés?
O superstitions obscures et sanglantes!
Sacrifices hideux fumant au bord des flots,
Longues processions de victimes dolentes,
Chaînes, croix et carcans et chastetés brûlantes,
Vous avez pour toujours éveillé nos sanglots!
Comment vous effacer jamais de nos mémoires?
Il nous faut remonter tous vos sentiers maudits,
Saigner tous vos tourments, lire tous vos grimoires,
Car vos crosses, vos clefs, vos chasubles de moires
Cachent encor le seuil de nos vieux paradis.
O Nature, Nature, oh! dis, tes bras de mère
S'ouvriront-ils encor pour tes fils révoltés?
Nous voulions t'arracher notre vie éphémère;
Mais nous y renonçons... L'épreuve est trop amère,
Et nous tombons, martyrs de nos divinités!
Pour naître, nous quittons tes entrailles fécondes;
Pour vivre, il faut ton air qui joue en nos poumons,
Il faut tes fruits, ton blé, la fraîcheur de tes ondes;
Pour aimer, il nous faut les caresses fécondes;
C'est aussi sur ton sein que nous nous endormons.
Avons-nous tant parlé pour découvrir ces choses?
Cent siècles ont passé, le jour est-il plus beau?
Paraît-il dans les nids plus de métamorphoses,
Plus d'étoiles au ciel, plus de feuilles aux roses,
Depuis que nous restons penchés sur un tombeau?
Quoi! mourir est-il donc un problème si sombre?
N'est-il point de splendeur dans un couchant vermeil?
Tout s'éteint, douce loi. Pendant les nuits sans nombre,
Alors que nous fermions nos paupières dans l'ombre,
Nous est-il arrivé de craindre le sommeil?
Apprendrons-nous enfin à garder le silence,
A demeurer muets devant les morts pensifs?
A quoi bon tant de mots? Lorsque avec violence
La passion en nous se déchaîne et s'élance,
Nos plus informes cris sont les plus expressifs.
Que valent nos discours? En supposant un être
—Un monstre, un malheureux—qui n'eût jamais aimé,
Et qui, voulant un jour à cette aurore naître,
Dans des livres choisis chercherait à connaître
Les douloureux bonheurs dont le monde est charmé:
Sentirait-il, du chœur confus de nos paroles,
Monter le frisson fou qui dévore la chair,
Et l'éblouissement qui met des auréoles
Blanches autour du front riant de nos idoles?
Saurait-il tout le prix de ce qui nous est cher?
Non: ceci ne s'apprend qu'au fond des yeux sans voiles,
Dans les bras enlacés et dans les cœurs unis,
Dans les torrents de feu qui parcourent nos moelles.
Pour savoir ce qu'on doit savoir sous les étoiles,
Fermons le livre obscur et regardons les nids.
Que l'austère sagesse interdit à l'amour,
Que tout fragile cœur pourtant au cœur qu'il aime
Veut redire à son tour.
«Toujours!...» Nous avons dit: «toujours!» nous dont les âmes
Acceptent fièrement l'universel destin
Et roulent, fleuves purs, se perdre dans les lames
D'un océan lointain.
Nous l'entendons mugir quand nous prêtons l'oreille,
Cet abîme profond aux antres ténébreux,
Et nous avons pu dire une chose pareille,
Et nous sentir heureux!
Oui, car nous méprisons l'âpre mélancolie
Qui fait pâlir les fronts quand luit la vérité.
Notre «toujours» à nous s'efface et s'humilie
Devant l'éternité.
Mais il n'en est pas moins joyeux lorsqu'il palpite,
Sublime et vain serment, sur nos lèvres de chair.
Nous savons où le Temps entraîne et précipite
Tout ce qui nous est cher.
Si nous la murmurons, la trompeuse parole,
A ceux de qui demain viendra nous séparer,
C'est que l'amour poursuit cette illusion folle
Et veut s'en enivrer.
Car, bien qu'il soit trop vrai que tout meurt et s'oublie,
L'amour déjà n'est plus s'il croit qu'il peut finir.
Nous aurions blasphémé, si l'aveu qui nous lie
N'engageait l'avenir.
Et vous ignoreriez la véritable ivresse
Si, bravant la raison sur son trône usurpé,
De votre cœur le cri d'éternelle tendresse
Ne s'était échappé.
Mais vous m'avez donné cette joie infinie.
Qu'importe que je meure et que les temps soient courts!
A votre lèvre enfin, qui raille, doute et nie,
J'ai fait dire: «Toujours!»
Briserait l'homme, astre humble et qui dans l'ombre a lui,
L'homme encor, méprisant l'univers en démence,
Serait plus grand que lui.
«Tandis que la matière au hasard s'évertue,
Lui, l'atome pensant, songe avant de périr;
Le monde en l'écrasant ignore qu'il le tue;
Lui, sait qu'il va mourir.»
Et moi, je te réponds: Immortel solitaire,
Penseur sombre et puissant qui refusas d'aimer,
Notre orgueil est plus haut, mais ton génie austère
N'a point su l'exprimer.
Si nous sommes très grands, si l'univers s'incline
Devant le rayon pur qui tremble sur nos fronts,
C'est que nous enlaçons d'une étreinte divine
Ceux que nous adorons.
C'est en les possédant que dans nos courtes heures
Nous sommes les rivaux de l'Infini sacré;
Lui seul nous les reprend lorsque dans ses demeures,
Morts, ils ont pénétré.
Il les berce à jamais sur son sein formidable,
Comme nous les bercions pendant les nuits d'amour;
Mais il reste jaloux dans le temps insondable
De nos baisers d'un jour.
Car à nos bien-aimés, en sa longue caresse,
S'il dispense la paix et l'oubli précieux,
Leur rend-il un instant l'ombre de cette ivresse
Que leur versaient nos yeux?
Non, non!... Qu'il vienne alors et saisisse sa proie!
Nous demeurons vainqueurs même au jour des adieux.
Quand un cœur frémissant par nous s'emplit de joie,
Nous devenons des dieux.
Vous tourniez lentement, tandis que je songeais.
Vos pas foulaient le poil des tigres du Bengale,
Fauve, pailleté d'or et marqueté de jais.
Vos voyages lointains ont orné cette salle;
Vingt pays ont produit ces merveilleux objets.
Tout en pressant du pied la peau, robe royale,
Vous formiez de nouveaux et hasardeux projets.
Mais, beau tigre enfermé dans ma passion folle,
—Cage où s'épuiserait votre fureur frivole,—
Comment partiriez-vous, étant ainsi captif?
De vos grands fauves morts, couchés, les yeux sans flamme,
Certes je verrai l'un avant vous fugitif!
Car pour vous rendre libre il faut briser mon âme.
Dans la pourpre enchâssé, l'acier pur étincelle;
On dirait qu'un sang frais en longs filets ruisselle
Sur le tranchant aigu du clair et fin poignard.
Le courbe yatagan lance un éclair hagard;
Sa gaîne s'est usée à battre sur la selle;
Et cette svelte dague, arme charmante, est celle
Où Tolède épuisa son adresse et son art.
Toutes les voici donc, l'atroce avec l'exquise,
Chacune ayant été par vous au loin conquise,
Ces lames dont la pointe aime à percer les chairs.
Leur lit d'obscur velours les porte inassouvies,
Car des cruels baisers qui leur furent si chers
La soif les brûle encor, ces buveuses de vies.
Vous courbiez sur nos fronts vos feuillages si doux,
Qu'assombrissait la nuit divine;
Et nous pouvions errer en nous disant tout bas
Ces choses que, souvent, l'oreille n'entend pas
Tandis que le cœur les devine.
Hélas! et mes discours vous ont tous mis en deuil.
J'ai laissé s'élever la voix de mon orgueil
Dans votre auguste et pur silence,
Et j'ai blessé celui qu'en secret vous charmiez.
Dites, m'écoutiez-vous quand vous vous endormiez
Au vent du soir qui vous balance?
Lui—lui, qui s'irritait—ne souffre déjà plus,
Car j'ai chargé son mal de baumes superflus;
J'ai guéri sans peine sa plaie.
Il sait que je suis fière et qu'il était jaloux,
Et que l'amour parfois, dans ses caprices fous,
Met notre âme ainsi sur la claie.
Mais vous, m'accordez-vous aussi votre pardon?
Vous avez par moments de doux airs d'abandon
Qu'avec ivresse je contemple;
Vous murmurez des bruits tendres comme des mots,
Et vous arrondissez vos superbes rameaux
Ainsi que les arceaux d'un temple.
Le jour, des fleurs sans nombre émaillent vos sentiers.
Vous êtes rayonnants, sur vos sommets altiers
L'azur tend ses immenses toiles;
Mais je vous aime mieux dans le calme des soirs,
Quand vous êtes pensifs, et que vos arbres noirs
Pour fruits d'or portent des étoiles.
Si jamais j'ai rêvé de bonheur infini,
Sans cesse j'y mêlais votre charme béni,
O grands bois frissonnants et sombres!
Afin de l'enchanter d'un songe surhumain,
J'avais conduit celui que j'aime par la main
Dans la profondeur de vos ombres.
Et puisque je l'ai fait souffrir dans ces beaux lieux,
Puisqu'il a pu, sous votre abri mystérieux,
Douter de mon amour sans bornes,
Je vous croirai toujours irrités contre moi,
Et je verrai toujours en tressaillant d'effroi
Frémir vos hautes cimes mornes.
Mais du moins entendez aujourd'hui mon serment:
Lorsque je marcherai pas à pas, lentement,
Près de lui sous vos voûtes fraîches;
Soit que le gai printemps fasse éclore les nids,
Soit que le vent d'hiver sur les chemins brunis
Roule à nos pieds vos feuilles sèches;
Craignant l'âpre regret et l'amer souvenir,
Je ne laisserai point à ma lèvre venir
Des mots moins doux que ma pensée.
De mes torts d'un instant, bien que légers et courts,
Humble, je veux distraire et consoler toujours
Sa chère âme que j'ai blessée.
Et s'il veut éprouver son pouvoir absolu,
—Ce pouvoir sous lequel l'amour a résolu
De plier ma fière nature,—
Docile, il me verra suivre ses volontés,
S'il vous invoque et s'il m'entraîne à ses côtés
Dans vos abîmes de verdure.
Et vous pouvez être jaloux!
Ami, ma lèvre ne respire
Que pour vous.
Quoi! vous éprouvez ma tendresse,
Et vous redoutez l'avenir!
Vous croyez donc que votre ivresse
Peut finir?
Savez-vous que mon cœur frissonne
Quand votre front est soucieux?
Mon bonheur s'efface ou rayonne
Dans vos yeux.
Un mot de vous change mon âme:
Aussi longtemps qu'il vous plaira,
Votre souffle de cette flamme
Se jouera.
Cher tyran qui prenez ma vie,
Vous me la rendez quelquefois:
C'est lorsque j'écoute, ravie,
Votre voix;
Ou bien lorsque mon regard plonge
Dans votre œil au rayon béni,
Et que je m'enivre d'un songe
Infini.
J'aime inventer des rimes folles
Pour vous les murmurer tout bas;
Vous n'êtes de leurs sons frivoles
Jamais las.
Alors qu'ainsi je vous enchante,
Quand vous vous inclinez vers moi,
Et que le rythme ailé vous chante
Mon émoi,
Nous avons le bonheur suprême,
Et tous nos désirs superflus
Ne demanderaient à Dieu même
Rien de plus.
Qui jadis habitiez d'inaccessibles cimes,
Mes beaux oiseaux sacrés!
Vous êtes descendus vivants parmi les hommes,
Dans la réalité triste et sombre où nous sommes,
Purs vous êtes entrés.
Je vous croyais trop beaux pour ce monde où tout pleure,
Et voici que soudain au toit de ma demeure
Se suspend votre vol.
Quand l'aube luit j'entends frémir vos douces ailes,
Et le soir vos chansons me font oublier celles
Du divin rossignol.
Mes yeux vous ont suivis, pleins de larmes amères,
Lorsque vous sembliez, visions éphémères,
Fuir au sein de l'azur.
Mon cœur de votre adieu se brisait en silence...
Et voici qu'aujourd'hui votre nid se balance
A l'angle de mon mur.
Que vous êtes charmants, fiers et joyeux, mes hôtes!
Je vous ai vus planer dans des sphères très hautes,
Parmi des rayons d'or;
Tremblante, j'admirais votre splendeur farouche;
Mais vous apparaissez, sous ma main qui vous touche,
Plus radieux encor.
L'un de vous est l'Amour, sûr, profond et fidèle,
L'Amour au vaste essor, dont le large coup d'aile
Vibre dans l'infini;
L'autre est l'Intimité qui fait une deux âmes;
L'autre est la Poésie à l'aigrette de flammes,
Chantant son chant béni.
Tous vous êtes venus, chers captifs de ma vie.
Un seul eût pu me rendre heureuse à faire envie;
Pourtant j'aurais souffert,
Car mes vœux insensés vous appelaient ensemble.
Mais le sort en un jour à mon seuil vous rassemble,
Et mon ciel s'est ouvert.
Amour!... Culte du beau!... Communion suprême!...
Oh! sentir qu'on s'élève au-dessus de soi-même,
Que le cœur s'agrandit,
Que l'on voit de plus loin la foule et ses mensonges,
Parce qu'un œil aimé plein de merveilleux songes
Doucement resplendit!
Oh! dans un clair esprit lire comme en un livre,
Surprendre sa pensée et la faire revivre
En des rythmes légers!
D'un être grave et fort vaincre l'orgueil austère,
L'entendre murmurer que rien ne vaut sur terre
Nos aveux échangés!
Découvrir à la fois dans la main que l'on presse
La virile énergie et l'exquise tendresse,
Un ferme et cher soutien!
Être deux, se livrer sans jamais se connaître,
Et se trouver nouveaux et plus charmants peut-être
Après chaque entretien!
Aimer tous deux les champs où frissonnent les roses,
Les flots bleus, les parfums, les puériles choses,
Les bois mystérieux!
Accueillir la gaîté qui rit et qui s'éveille,
Et fixer sur la vie, étonnante merveille,
Un regard sérieux!
Tout voir, tout admirer, tout chercher, tout comprendre
Au fond d'un cœur, miroir qui prend tout pour tout rendre,
Cœur à notre âme uni;
Savoir que rien n'est beau ni grand qu'il ne reflète,
Et, comme en s'y peignant l'univers s'y complète,
Y trouver l'infini!
O rêves, rêves d'or que formait ma jeunesse!
Vous êtes devenus, riants et pleins d'ivresse,
Une réalité.
Je ne demande rien que prolonger cette heure:
Dieu même n'en ferait pour moi point de meilleure
Dans son éternité.
Où rayonne l'amour sur la bruyère en fleur!
Ils ne vous ont chantés, les orgueilleux poètes,
Qu'au sein de leur douleur.
Ils ne vous ont parlé, par leurs voix immortelles,
Que lorsque en vos abris ils sont revenus seuls,
Et qu'ils n'ont plus trouvé sous vos ombres si belles
Que d'horribles linceuls.
Leurs vers ont découlé de leur lèvre tremblante
Lorsqu'ils ont parcouru votre désert sacré,
Y suivant pas à pas la fuite grave et lente
D'un fantôme adoré.
Et ce n'était point vous alors que leur tristesse
Se plaisait à parer d'un charme déchirant:
C'était leur amour mort et c'était leur jeunesse
Qu'ils cherchaient en pleurant.
Ils vous ont accusés de rester impassibles
Lorsqu'ils marchaient pensifs en sanglotant tout bas,
Et que dans vos sentiers leurs rêves impossibles
S'envolaient sous leurs pas.
Bien peu leur importaient vos airs gais ou moroses
Quand leur bonheur semblait ne pas devoir finir,
Mais plus tard ils ont dit que l'éclat de vos roses
Blessait leur souvenir.
Ils se sont étonnés que vos grâces divines
Devant leur désespoir resplendissent toujours,
Et que vous n'eussiez point fait prendre à vos ravines
Le deuil de leurs amours.
Que n'ai-je, ô bois charmants, leur sublime génie,
Puisque je suis heureuse et que vous m'enchantez,
Puisque celui dont l'âme à mon âme est unie
S'avance à mes côtés!
Puisque je vois briller parmi vos frêles herbes
En paillettes de feu les traits d'or du soleil,
Et que sur les sommets de vos arbres superbes
Reluit le jour vermeil!
Puisque tout est chansons, que tout est rire et joie
Sous vos ombrages frais, dans les cieux, dans mon cœur!
Oh! pourquoi donc faut-il que l'écho ne renvoie
Que l'accent du malheur?
Pourquoi n'avons-nous pas des mots pleins de délire
Qui fixent à jamais nos bonheurs fugitifs,
Alors qu'un léger mal arrache à notre lyre
Des accords si plaintifs?
Pour élever vers vous une voix attendrie,
Beaux asiles profonds où mon cœur fut bercé,
Non, je n'attendrai point l'heure où la rêverie
S'en va vers le passé.
Non, je n'attendrai point de la trouver déserte
La place où mon ami se reposa souvent,
Et seule d'écouter dans la forêt inerte
Les longs soupirs du vent.
Voyez, nous sommes deux, nous savons vous comprendre,
Notre aveugle bonheur ne cache point vos cieux,
Votre sereine paix rend notre amour plus tendre
Et plus mystérieux.
Nous revenons à vous toujours, ô solitude!
Votre calme imposant plaît à notre fierté;
Les bois silencieux, dans leur noble attitude,
Ont tant de majesté!
Notre âme, qui remonte aux sources de la vie,
D'un monde étroit et vain fuyant les trahisons,
S'agrandit tout à coup et s'élance ravie
Vers vos purs horizons.
Nos pas en vos chemins errent à l'aventure,
Vos aspects imprévus nous font longtemps rêver,
Et tout autour de nous la tranquille Nature
Semble nous approuver.
Qu'il monte donc vers vous, l'encens de nos hommages,
Dans nos félicités il doit vous être offert;
Et puissions-nous encor vous bénir, ô bocages,
Quand nous aurons souffert!
Aujourd'hui, l'œil perdu dans vos riants abîmes,
Nous sentons les liens qui nous tiennent unis,
Se serrant doucement au souffle de vos cimes,
Devenir infinis;
Et, songeant que demain les heures envolées,
Blancs spectres, flotteront en ces muets séjours,
Émus, nous voyons naître en vos vertes allées
Les plus beaux de nos jours.
Bien que l'exil fût court, volontaire et joyeux,
J'ai surpris un reflet de rapide souffrance
Qui passait dans vos yeux.
C'est lorsque le rivage, avec ses contours vagues,
S'est perdu lentement dans une brume d'or.
Rose, au loin la falaise, à l'horizon des vagues,
Étincelait encor.
Vous m'avez avoué qu'une étreinte secrète
Toujours vous oppressait le cœur, lorsque au départ
Nos bords si familiers, noyant leur fine crête,
Échappaient au regard.
Mais pouvais-je éprouver un sentiment d'angoisse,
Moi... moi qui m'enfuyais loin du monde avec vous,
De ce monde cruel, dont un seul coup d'œil froisse
L'amour furtif et doux?
Ah! goûter un instant sur la terre étrangère
Ces bonheurs par le sort à jamais déniés!
Ah! croire pour un jour—ivresse mensongère—
Que vous m'apparteniez!
Marcher à votre bras sans plus d'inquiétude,
Parmi tant d'inconnus, qu'au fond des grand bois noirs
Qui nous ont si souvent prêté leur solitude
Dans la paix des beaux soirs;
Et ne pas me troubler devant tant de prunelles
Pénétrant à loisir mon secret précieux,
Plus que sous les yeux d'or aux lueurs éternelles
Qui nous guettent des cieux;
Porter haut votre amour ainsi qu'une auréole,
Le sentir rayonnant sur mon front, et passer
Sans trembler de surprendre une injuste parole
Prompte à le rabaisser;
Vous posséder sans cesse: en ouvrant ma paupière
A l'aube, et jusqu'au soir où nous rentrerions las;
Vous suivre tout le jour, et la nuit tout entière
Dormir entre vos bras:
Voilà l'illusion qu'un rapide voyage
Pour un moment changeait en douce vérité,
Et qui m'apparaissait quand j'ai vu le rivage
S'enfuir dans la clarté.
Car, vous le savez bien, pour toute femme aimante
Il n'est qu'une patrie et qu'un vrai sol sacré:
La terre qu'embellit la présence charmante
D'un seul être adoré.
Qu'importe au prisonnier la splendeur d'un beau jour?
Quel bien pourrait remplir mon âme inassouvie
Si je n'ai pas l'amour?
Si je n'ai votre cœur,—le vôtre, ô ma chère âme!—
Que m'importe la gloire, enivrante liqueur?
Son nectar à ma lèvre est comme une âpre flamme
Si je n'ai votre cœur.
Si je n'ai votre espoir, cher, et votre pensée,
Qu'importent mes travaux, sous la lampe, le soir?
Qu'importent mes efforts et ma lutte insensée
Si je n'ai votre espoir?
Si je n'ai vos bonheurs pour enchanter ma course,
Qu'importe l'aiguillon des désirs suborneurs?
Toute félicité m'est tarie en sa source
Si je n'ai vos bonheurs.
Si je n'ai vos tourments, peu m'importent les larmes
Que versent ici-bas les douloureux amants:
L'ineffable pitié même est pour moi sans charmes
Si je n'ai vos tourments.
Si je n'ai vos fiertés, qu'importe qu'on me blesse?
Qu'importent les dédains par avance acceptés?
Tous les souffles amers courberont ma faiblesse
Si je n'ai vos fiertés.
Si je n'ai vos aveux à répéter en rêve,
Qu'importe que la nuit vienne au gré de mes vœux,
Sous les astres, chanter son doux hymne sans trêve,
Si je n'ai vos aveux?
Si je n'ai votre amour, que m'importe la tombe?
Qu'importent tous mes ans moissonnés sans retour?
Que le sépulcre s'ouvre, ô cher, et que j'y tombe
Si je n'ai votre amour!
La cage et le nid désormais déserts,
Qui donc chantera pour vous de doux airs?
Qui donc vous mettra tout le cœur en fête
Quand s'envolera la chère fauvette?
Dans les jours de trouble et de dur souci,
Elle avait toujours, malgré ses alarmes,
Un chant dont le ciel semblait éclairci,
Un chant quelquefois tout trempé de larmes,
Dans les jours de trouble et de dur souci.
Hélas! elle était quelque peu farouche,
Ne ressemblant guère aux oiseaux privés
Qui vous becquetaient jadis dans la bouche,
—Gens de basse-cour, des bourgeois rêvés.—
Hélas! elle était quelque peu farouche.
Elle aimait, c'est vrai, le feuillage altier
Où le libre vent siffle quand il passe.
N'effleurant jamais le banal sentier,
Elle volait haut dans l'immense espace.
Elle aimait, c'est vrai, le feuillage altier.
Vous vouliez ses chants sans avoir son âme.
Pourriez-vous sentir la tiédeur du feu
Sans laisser jaillir et danser la flamme?
La fauvette part au fond du ciel bleu...
Vous vouliez ses chants sans avoir son âme.
Mais quand s'ouvriront pour votre fauvette
La cage et le nid désormais déserts,
Qui donc chantera pour vous de doux airs?
Qui donc vous mettra tout le cœur en fête
Quand s'envolera la chère fauvette?
Vous avez seul promené vos ennuis.
Dans nos grands bois, sous la lune d'opale,
N'avez-vous point entrevu mon front pâle?
L'air était plein des senteurs du lilas.
Vous marchiez seul, pensif et le cœur las.
A l'heure où tout sommeille et tout s'apaise,
L'ancien amour, est-ce lui qui vous pèse?
L'esprit peut-être, ou peut-être la chair,
Hait en secret ce qui nous est trop cher.
C'est la révolte obscure et douloureuse
De l'âme, en qui plus d'un gouffre se creuse.
Nous ignorons l'énigme qu'il recèle,
Un sceau divin pour nous-mêmes le scelle.
Nous le frappons pour en troubler l'écho:
L'écho s'éveille et ne rend qu'un sanglot.
Ah! n'allez plus, ami, dans le bois sombre
Des jours perdus compter ainsi le nombre.
N'allez plus seul en nos anciens abris,
D'un rêve amer vous y seriez surpris.
Non, n'allez plus à cette chère place
Sans que mon bras si tendre vous enlace.
Car le Passé, sphinx aux rires railleurs,
Nous guette aux lieux qui furent les meilleurs.
Et moi, je puis faire encore, ô ma vie!
Un doux Présent pour votre âme ravie.
Le premier vent d'automne a tristement soufflé.
Nos bois se sont emplis d'un tumulte sauvage,
Dont mon trop faible cœur est jusqu'au fond troublé.
Car sous le sombre ciel meurt la saison bénie,
La rapide saison de nos bonheurs furtifs,
Et c'est un souffle plein d'amertume infinie
Qui tord et fait gémir les grands chênes plaintifs.
Reverrons-nous jamais la douce solitude
Où les bruits importuns du monde s'éteignaient?
Reviendrons-nous errer encor, sans lassitude,
Dans ces sentiers étroits où nos mains se joignaient?
Chérirons-nous longtemps d'une égale tendresse
Nos anciens nids d'amour perdus dans le bois frais?
Y viendrons-nous puiser toujours la même ivresse,
Sans jamais voir pâlir leurs immortels attraits?
La modeste demeure aux lourds meubles rustiques
Semblera-t-elle encor si touchante à nos yeux,
Parmi l'ombrage épais de ces forêts antiques
Où, dans l'austère écho, sonnaient nos pas joyeux?
Sur la haute colline en notre course atteinte,
Devant l'immense espace embrassé tant de fois,
Resterons-nous encor, lorsque l'Angelus tinte,
L'un sur l'autre appuyés, recueillis et sans voix?
Qui changera d'abord, la Nature ou nos âmes?
Hélas! et qui de nous se lassera d'aimer?
Suffiront-ils toujours à nos cœurs pleins de flammes,
Ces bonheurs d'aujourd'hui qui les ont pu charmer?
Oh! qu'il est triste à dire à la chère retraite
Le déchirant adieu qui nous sépare au seuil!
Voilà pourquoi naissait mon angoisse secrète
Devant le sombre aspect de la campagne en deuil.
Pleurez, ô grands bois noirs! Sifflez, ô vents funèbres!
Feuilles mortes, tombez sur le chemin durci!
Nuages, étendez vos voiles de ténèbres...
Mon cœur, qui vous comprend, se glace et tremble aussi.
Et pourtant je devrais bénir votre détresse:
Sans l'horreur de l'hiver, que vaudraient les beaux jours?
Sans le cruel adieu, la passagère ivresse
Mènerait aux sommeils insensibles et lourds.
Car en ce monde obscur dont la Mort est la reine
Tout s'efface et périt de ce qu'on veut saisir,
Mais qu'un bien seul échappe à la loi souveraine,
C'est assez pour qu'en nous en meure le désir.
Ami, plus l'avenir nous réserve de larmes,
Plus sembleront pesants nos jours chargés d'ennuis,
Et plus rayonneront les indicibles charmes
De nos discrets bonheurs, si promptement enfuis.
Puis, lorsqu'un doux printemps fera verdir les branches,
Peut-être, revenus en notre ancien séjour,
Parmi les frais lilas et les épines blanches,
Nous verrons refleurir notre immortel amour.
Nous avions devisé devant la nappe blanche.
Pour si peu quelquefois le cœur entier s'épanche.
Tous nos bonheurs passés renaquirent soudain
Sous la tonnelle verte, au fond du frais jardin.
Dans la nuit magnifique, au calme clair de lune,
Le long train, serpentant parmi les noirs massifs,
Nous ramena bien tard vers Paris, tout pensifs,
Échangeant en baisers notre extase commune,
Dans la nuit magnifique, au calme clair de lune.
Sur votre épaule, ami, j'avais posé mon front.
Nous étions seuls. Au loin fuyaient les douces plaines.
L'air vif, en se jouant, confondait nos haleines.
(Jusqu'à la mort ainsi nos bouches se joindront.)
Sur votre épaule, ami, j'avais posé mon front.
Je vous disais des mots très lents, d'une voix basse.
Les grands arbres couraient; les groupes des maisons
Piquaient d'étoiles d'or les sombres horizons;
Quelque heure au loin sonnait, légère, dans l'espace.
Je vous disais des mots très lents, d'une voix basse.
Je vous disais: «Voilà l'image de nos jours:
Enlacés, nous verrons la fuite des années
Partout disjoindre, unir, briser des destinées,
Et nous nous appuierons l'un sur l'autre, toujours.»
Je vous disais: «Voilà l'image de nos jours.»
Les bois, les champs dormaient, baignés de clartés bleues.
Le grand train mugissait comme un monstre affolé
Qui se fût dans l'abîme à jamais envolé,
Entre la terre et nous mettant cent mille lieues.
Les bois, les champs dormaient, baignés de clartés bleues.
Je n'avais pas besoin de relever les yeux
Pour sentir jusqu'au cœur vos regards enivrés
Qui se posaient sur moi, noyés de pleurs sacrés,
Me causant un frisson aigu, délicieux...
Je n'avais pas besoin de relever les yeux.
Et ce fut un instant plus beau qu'un très beau rêve.
La Nature est vraiment une argile en nos mains;
Nous pouvons en tirer des bonheurs surhumains,
La transformant au gré d'une chimère brève.
Oui, ce fut un instant plus beau qu'un très beau rêve.
Qui t'a charmé jadis et vaincu par ma voix;
Ton cœur veut s'enchanter de la rime légère,
Ce soir, comme autrefois.
Tu me dis doucement, tout bas, le regard triste:
«Après le mois des nids, les chants sont superflus.
Ma fauvette se tait... Son amitié subsiste,
Mais son amour n'est plus.
«A l'heure du désir, sous la tendre feuillée,
En mai, la chanson part et vibre en liberté;
Mais, plus tard, la forêt s'apaise, ensommeillée,
Durant le morne été.
«Et toi, chère âme ardente et vive de poète,
Tu nous fais des printemps très brillants, mais très courts.
Le mien s'est envolé, car te voilà muette,
Et depuis bien des jours.»
Méchant! Qu'as-tu pensé?... Ton reproche morose
Me fait haïr la rime au double écho moqueur.
Que t'importent, dis-moi, soit les vers, soit la prose,
A toi qui vois mon cœur?
Cependant ton regret réveille dans mon âme
Comme un concert lointain de nos hymnes chéris.
Je veux revoir briller la même heureuse flamme
En tes yeux attendris.
Puisque tu n'es point las de mes cris de tendresse,
Penche-toi sur ma lèvre, ils y vont éclater.
Puisque pour toi mes chants offrent la même ivresse,
Je veux, je veux chanter!
Le doute bien connu que trahit ta prière,
N'excite plus en moi de soucis anxieux;
Je sais le dissiper, souriante et très fière,
D'un regard de mes yeux.
Si donc en rythmes vains ma bouche balbutie
Cet amour, qui grandit encore au fond de moi,
Ce n'est point, cher jaloux, qu'en rien je me soucie
De ton injuste émoi.
Non, c'est que tu te plais à mes frivoles rimes,
C'est que je pense et parle et vis pour ton plaisir,
Et que j'ai, pour franchir toutes les hautes cimes,
L'aile de ton désir.
Où nous aurions vécu seuls et loin d'ici-bas,
Couple unique, bercé d'un séduisant mensonge,
Ignorant à jamais les vulgaires combats.
Vous n'avez pas voulu... Car votre regard plonge
Dans l'âpre Vérité, que je ne connais pas,
Et cette Vérité, dont le désir vous ronge,
Seule a pu vous offrir d'indicibles appas.
Vous avez dédaigné mon rêve de poète,
Et, dissipant l'espoir de ma pauvre âme en fête,
Vous m'avez prodigué votre cruel savoir.
Soit... Marchons donc, ami, tout simplement sur terre.
Mon cœur a, près de vous, choisi la route austère...
Mais laissez-moi fermer les yeux, pour ne pas voir.
Combien ce mot étrange est vide de pensée,
Ce mot dont l'âme humaine est à jamais bercée
Entre la terre sombre et le ciel hasardeux.
Pourtant nous l'avons dit, et sur ma lèvre folle
Avec une âpre ardeur il est souvent venu;
Je l'ai vu rayonner surtout dans l'inconnu:
Mon cœur s'est fatigué de ce tourment frivole.
Et je vous ai parfois vous-même fait souffrir,
Car n'ayant nulle idole et nul espoir au monde
Hors vous, je m'irritais, en mon erreur profonde,
Que votre main ne sût d'un tel mal me guérir.
L'extase que le moine en sa froide cellule
Trouve en Dieu, les vapeurs du haschisch et du vin,
Ce qu'au monde réel l'homme demande en vain,
Cet idéal fuyant dont le désir nous brûle,
J'ai voulu l'obtenir—moi qui n'y croyais pas—
D'un amour surhumain, sans faiblesse et sans trêve,
Et je vous ai troublé d'un impossible rêve,
Quand j'aurais dû charmer la route où vont vos pas.
Votre cœur tendre et fort comprend et me pardonne,
Mais je prends ma chimère orgueilleuse en mépris.
Ami, ma part de joie ineffable et sans prix,
C'est l'humble et doux bonheur qu'en secret je vous donne.
Où se fondait enfin tout l'orgueil de ton cœur.
Pardonne si ma lèvre a pu trouver des charmes
A goûter sur tes cils leur amère liqueur!
Les amants, torturés d'incessantes alarmes,
Et des soupçons jaloux épuisant la rancœur,
Jadis avaient du moins parmi leurs sûres armes,
Pour conquérir l'aimé, quelque philtre vainqueur.
La sorcière mêlait, pour le blond ou la brune,
Des simples merveilleux, cueillis au clair de lune,
Et dans son noir chaudron les cuisait jusqu'au jour.
Un philtre, dissolvant même les cœurs de pierre,
Ainsi me lie à toi d'un éternel amour:
Je l'ai puisé brûlant au bord de ta paupière.
Préférez-vous donc à mon rire
Mes pleurs?
Je suis trop prompte et trop fantasque,
C'est vrai. Mettrez-vous donc un masque
Aux fleurs?
Allez leur dire en la prairie:
«Enfants, il ne faut pas qu'on rie,
En l'air,
Au papillon qui rôde et vole,
Vous effleurant comme un frivole
Éclair.
«Mais si la joie est un vain leurre,
Il ne faut pas non plus qu'on pleure.
Or çà,
Sur mainte corolle irisée
J'aperçois l'eau que la rosée
Versa.
«Fleurs, il faut être philosophe.
Votre âme est de bien mince étoffe,
J'ai peur.
Maint frelon, dans son doux langage,
De son amour vous offre un gage
Trompeur.
«Le vent qui passe vous irrite.
Si le cœur de la marguerite
Est d'or,
Le bleuet manque de logique.
Le souci du moins est tragique
Encor;
«C'est une fleur grave et pensive,
Dont l'humeur est un peu moins vive;
Pour lui,
J'estime assez son air morose,
Qu'il reprend dès que l'aube rose
A lui.»
Les fleurs, Maître plein de science,
Trouvant tous vos sermons, je pense,
Bornés,
Sans raison peut-être et sans rime,
Vous riront, ô penseur sublime,
Au nez.
Moi, qui suis comme elles légère,
Du rire aux larmes passagère,
Rêvant
Quand il faudrait être profonde,
Livrant mon âme comme l'onde
Au vent,
J'encours encor plus votre blâme,
N'étant pas fleur mais étant femme,
Hélas!
La raison ne peut me séduire,
Et votre esprit de me conduire
Est las.
Ami, que je pleure ou je chante,
Qu'importe?. . . Mon rêve m'enchante
Un jour.
Méritez-vous qu'on vous écoute?
C'est vous qui mîtes sur ma route
L'amour.
Qui m'obsède,
Vous avez un pouvoir si tendre que souvent
Je vous cède.
Nonchalante, le soir, près du feu je m'assois,
Sous la lampe.
Grave, alors vous venez, et vous posez les doigts
Sur ma tempe.
Droit au fond de mes yeux vous plongez longuement
Vos prunelles,
Astres dont les lueurs sont pour mon cœur aimant
Éternelles;
Car toujours, dans l'abîme où, par un sort affreux,
Tout retombe,
Je les verrai briller au plafond ténébreux
De ma tombe.
Elles dardent en moi par leur regard profond
Tant de flammes,
Que leur feu lentement dissout, change et confond
Nos deux âmes.
Et sur mon front soumis vos caressantes mains,
Empressées,
Glissent en mon esprit par de subtils chemins
Vos pensées.
Moi, je vous laisse faire, et tout bas je bénis
Ma névrose.
Je vois, en ces moments de plaisirs infinis,
Tout en rose.
De vos grands yeux aimés au doux rayon charmeur
Je me grise,
Et j'admire en secret de votre art endormeur
La méprise:
Car l'effluve magique en mon sang nuit et jour
Qui ruisselle
N'a pas de nom savant, et votre seul amour
M'ensorcelle.
Jaillira quelque jour un vif et pur rayon.
Dans les champs de l'esprit nos âmes enlacées,
Bravant l'aveugle nuit et l'âpre tourbillon,
Vont tracer jusqu'au bout leur immortel sillon.
Vous, vous aurez la force, et j'aurai l'espérance.
Nous serons moins troublés par le néant humain,
Nous aurons plus d'ardeur et de persévérance,
Ami, puisque ma main serrera votre main
Et que nous serons deux dans l'éternel chemin.
Certes, elle est immense et sombre, notre voie;
L'univers la poursuit vers un but décevant.
Pourtant c'est la meilleure et la plus noble joie
D'y marcher en premier contre l'ombre et le vent
Et de crier bien haut et toujours: «En avant!»
Nous n'arriverons point,—car jamais on n'arrive.—
Mais que m'importe, à moi qui vous suis pas à pas?
Le bord où vous touchez, c'est ma suprême rive;
Vous y suivre est l'espoir dernier de mes combats:
Je ne veux pas savoir ce qui brille là-bas.
Des feux follets ardents qui guident l'âme humaine,
Idéal, Vérité, Loi, Justice, Infini,
Le seul qui m'ait charmée et qui si loin me mène,
Le seul qui pour mes yeux ne se soit point terni,
C'est l'Amour doux et fort, l'Amour tendre et béni.
C'est lui qui m'entraîna dans des sentiers sublimes.
Tout ce que j'ai compris, il me l'a révélé.
Et si je dois gravir encor de hautes cimes,
C'est qu'en vous poursuivant sur le roc désolé
Je franchirai le sol que vous aurez foulé.
Ami, conduisez-moi plus haut, plus haut encore,
Et ne redoutez pas de me lasser jamais.
Ce n'est point que la soif de savoir me dévore,
Mais vous partiriez seul pour ces lointains sommets. . .
Or mon cœur ne peut plus vous quitter désormais.
Je lisais de doux vers.—Voici
Que souriante et douce aussi
Votre image m'est apparue.
Le livre a glissé de mes doigts.
Sur l'oreiller peuplé de songes,
Avant de subir leurs mensonges,
Il est bon de penser, parfois.
Quel silence sur toute chose!
Ma chambre, en son intimité,
Se recueille sous la clarté
De ma lampe au fin globe rose.
Je vous aime depuis quatre ans.
Quatre ans!. . . Ils ont passé bien vite.
Les ai-je trouvés, dans leur fuite,
Tristes?. . . joyeux?. . . indifférents?
Ils n'ont point été sans nuage:
Vous m'avez parfois fait pleurer.
Quelle adresse à se torturer
Peut montrer l'amant le plus sage!
Vous vous mêliez d'être jaloux;
Je me fâchais de vos boutades.
Oui, nous eûmes des jours maussades,
Ami, vous en souvenez-vous?
Il fut une heure plus amère,
Quand votre esprit audacieux
Vous fit au loin, sous d'autres cieux,
Suivre votre haute chimère.
Oh! le train qui siffle et qui part!
Peut-on se quitter quand on s'aime?
Quel prix, à cet instant suprême,
Prend un mot, un geste, un regard!
Mais, pour ces moments de détresse,
Bien d'autres j'en pourrais compter
Qui sont venus les racheter,
Tout remplis d'une exquise ivresse.
Ainsi donc, remontant le cours
Des quatre dernières années,
Je vois des heures fortunées
S'enlaçant à de sombres jours.
Ce que ma mémoire attentive
Ne trouve point en ce passé:
Ni dans le tourment insensé,
Ni dans l'extase fugitive,
C'est—soit qu'il fût profond et doux,
Soit qu'il brûlât comme une flamme—
Un sentiment, ô ma chère âme,
Qui ne me fût venu par vous.
Sous son grand manteau tout de noir velours;
La brume obscurcit la longue avenue...
Mais, tout bas, mon cœur, qui t'aime toujours,
Chante la chanson de toi bien connue.
Le soleil s'éteint; la pluie est venue,
Ses voiles tremblants flottent sur les bois;
L'horizon brouillé se perd sous la nue...
En moi doucement murmure une voix,
Une voix d'amour, de toi bien connue.
L'été s'est enfui; la neige est venue;
L'infini silence emplit nos forêts,
La lune pâlit leur cime chenue...
Mon cœur se souvient: elle a tant d'attraits,
L'histoire d'hier, par toi bien connue!
Les ans passeront. Quand sera venue
La mort, qui clora mes yeux pour jamais,
Qu'alors dans ta main ma main soit tenue,
Afin que mon âme, ô toi que j'aimais,
S'endorme en l'extase où tu l'as connue.
Sont les vaincus du grand Amour sacré.
C'est pour jamais, mon amour, que je t'aime:
Je l'ai juré!
Je l'ai juré. Les bois sur la colline,
Les grands prés verts que parfument les foins,
Le ruisseau pur où le saule s'incline
Sont mes témoins.
Ils ont reçu ma suprême parole.
Si tu gémis, d'un doute torturé,
Que leur écho t'apaise et te console:
«Je l'ai juré!»
Nous vieillirons, car tout change sur terre.
Que ces amis, moins fragiles que nous,
Longtemps encor gardent dans leur mystère
L'aveu si doux.
Et quand, très tard, au déclin de ta vie,
Tu reviendras en notre cher séjour,
Que tout répète à ton âme ravie
Mon chant d'amour;
Ce tendre chant qu'en mes jeunes années
Je redisais pour charmer ton ennui:
A ses accents tes peines obstinées
Toujours ont fui.
Et cependant tu proclamais la femme
Un être frêle, impulsif, décevant...
Autant vaudrait se fier à son âme
Qu'aux jeux du vent.
Mais j'opposais à ton soupçon farouche
L'arrêt futur des rêveuses forêts,
Sachant qu'un jour les serments de ma bouche,
Tu les croirais.
Car s'il est vrai que tout meurt et s'efface,
Il est un bien que rien ne peut ternir,
Trésor qu'ici tout sentier te retrace:
Un souvenir.
Chacun poursuit sans repos sa chimère,
Rêve éternel dont le cœur est charmé.
Mais la moins vaine et la moins éphémère,
C'est—en ce monde où la joie est amère—
Avoir aimé.
Puisque vos sons, légers comme un battement d'ailes,
Quelquefois l'ont charmé.
Laissez-moi vous bénir, ô mes vers, frais calices,
Puisque mon bien-aimé respire avec délices
Votre souffle embaumé!
Vous l'avez consolé sur la rive lointaine.
Sans le quitter jamais dans sa route incertaine,
Vous chantiez sur son cœur.
Un peu de moi par vous vivait sur sa poitrine;
Il sentait naître en lui l'espérance divine
A votre accent vainqueur.
Le soir, il s'asseyait, lassé, pour vous relire;
La farouche forêt, vibrant comme une lyre,
Tout à coup se taisait.
Il n'entendait que vous dans l'immense nature,
Et le pesant souci de sa rude aventure
Un instant s'apaisait.
Vous portiez devant lui dans l'ombre et dans l'espace,
Afin de diriger ce voyageur qui passe,
L'amour, brillant fanal;
L'affreux péril en vain posait sur lui ses ongles,
Votre vive lueur éteignait dans les jungles
L'œil du tigre royal.
Il vous a répétés à l'écho des vieux temples,
Aux portiques déserts, montrant, mornes exemples,
Notre fragilité:
L'homme meurt, et ses dieux, que le temps brise et roule;
L'autel, étant de marbre, un peu plus tard s'écroule
Que la divinité.
Vous partagiez ainsi ses profondes pensées.
Vous lui devez la vie, ô strophes cadencées,
Il vous fit naître en moi.
Vous procédez de lui: moi qui suis votre mère,
Je ne vous ai donné que la grâce éphémère,
Lui, la force et la foi.
Partez pour l'enchanter, fruits d'un hymen sublime.
Votre naissance est haute, et pure, et légitime:
Qu'il soit donc fier de vous!
Vous êtes siens. Sans lui, vous dormiriez encore,
Germes obscurs marqués pour ne jamais éclore,
Dans le néant jaloux.
Souvent je sens en moi son esprit qui s'éveille;
Alors il faut écrire et prolonger la veille,
Et vous naissez, mes vers.
J'aime ce doux travail qui me tient accoudée:
Enfermer en tremblant l'essor de son idée
Dans mes rythmes divers.
Et s'il la reconnaît, pour peu qu'il lui sourie,
Si, puissante, elle vit sous la strophe fleurie,
Quel triomphe charmant!
Lorsque aussi pleinement deux êtres se possèdent,
Il n'est point sous le ciel de bonheurs qui ne cèdent
A leur enivrement.
Laissez-moi vous bénir, douces rimes fidèles,
Puisque vos sons, légers comme un battement d'ailes,
Quelquefois l'ont charmé.
Laissez-moi vous bénir, ô mes vers, frais calices,
Puisque mon bien-aimé respire avec délices
Votre souffle embaumé!


| VISIONS DIVINES | ||
|---|---|---|
| L'Œuvre des Dieux | 3 | |
| Fantômes divins | 5 | |
| La Charité de Bouddha | 10 | |
| L'Orient | 13 | |
| Le Progrès et les Dieux | 16 | |
| La Mort des Dieux | 19 | |
| Prière à Minerve | 22 | |
| LES VRAIS DIEUX | ||
| PROLOGUE | 31 | |
| I. | Le Désir | 32 |
| II. | L'Illusion | 35 |
| III. | La Mort | 38 246 |
| VISIONS ANTIQUES | ||
| La Main de la Momie | 43 | |
| Le Colosse de Memnon | 46 | |
| Une Victoire de Rhamsès II | 49 | |
| Les Loisirs de Sardanapale | 50 | |
| La Légende de Satni-Khamoïs | 53 | |
| SONNETS PHILOSOPHIQUES | ||
| DÉDICACE | 63 | |
| I. | Le Temps | 64 |
| II. | Les Forces | 65 |
| III. | La Vie | 66 |
| IV. | La Lutte pour l'Existence | 67 |
| V. | La Source | 68 |
| VI. | La Mort | 69 |
| VII. | Dieu | 70 |
| VIII. | Les premiers Ages | 71 |
| IX. | Les Sentiments | 72 |
| X. | La Raison | 73 |
| XI. | L'Idéal | 74 |
| XII. | Le Caractère | 75 |
| XIII. | L'Histoire | 76 |
| XIV. | La Morale | 77 |
| XV. | La Voix des Morts | 78 |
| XVI. | L'Œuvre de la Nature | 79 |
| XVII. | Les Races de l'Avenir | 80 |
| XVIII. | Les Pyramides | 81 |
| XIX. | Le But final | 82 247 |
| XX. | L'Atome humain | 83 |
| XXI. | La Fin d'un Monde | 84 |
| SURSUM CORDA! | ||
| SURSUM CORDA! | 87 | |
| SOUVENIRS | ||
| Souvenirs | 101 | |
| Éternel Désir | 104 | |
| Dans la Forêt | 106 | |
| Un Bal de l'Opéra | 109 | |
| A Leconte de Lisle | 110 | |
| Tête-à-tête romantique | 112 | |
| Paysage de Mai | 114 | |
| Paysage d'Octobre | 116 | |
| Deux Voix | 118 | |
| Souffles d'orage | 120 | |
| A Celui ou Celle qui viendra | 122 | |
| Une Aventure de l'Amour | 125 | |
| Sons et Parfums | 128 | |
| Le Sommeil | 129 | |
| Sur un Nuage | 131 | |
| Une Goutte d'eau | 133 | |
| Songe d'Été | 134 | |
| L'Ame et l'Univers | 137 | |
| PAROLES D'AMOUR | ||
| Aveu | 141 | |
| Rendez-vous | 144 248 | |
| Suprême Sagesse | 146 | |
| Pourquoi je l'ai aimé | 149 | |
| Philosophie | 152 | |
| L'Adieu | 156 | |
| Lettre écrite en Automne | 158 | |
| Inquiétude | 162 | |
| Le Collier de Perles | 165 | |
| L'Oubli | 168 | |
| Lettre écrite au Printemps | 170 | |
| Le Retour | 173 | |
| L'Inde Bouddhique | 176 | |
| Silentium | 180 | |
| Toujours | 186 | |
| Une Pensée de Pascal | 188 | |
| Les Peaux de Tigre | 190 | |
| La Panoplie | 191 | |
| Repentir | 192 | |
| L'Amour joyeux | 195 | |
| L'Heure enchantée | 197 | |
| La Nature et l'Amour | 201 | |
| Le Voyage | 205 | |
| Échos d'Amour | 208 | |
| La Fauvette | 210 | |
| Promenade solitaire | 212 | |
| Souffles d'Automne | 214 | |
| Mirages nocturnes | 217 | |
| Renouveau | 219 | |
| Rêve et Réalité | 221 | |
| Le Bonheur | 222 | |
| Lacrymæ sacræ | 224 | |
| Femme et Fleurs | 225 | |
| Sortilège | 228 249 | |
| Travaux communs | 230 | |
| Coup d'œil en arrière | 232 | |
| Pensées d'Automne | 235 | |
| Serments d'Amour | 237 | |
| A mes Vers | 239 | |

Achevé d'imprimer
le vingt-six octobre mil huit cent quatre-vingt-quinze
PAR
ALPHONSE LEMERRE
25, RUE DES GRANDS-AUGUSTINS, 25
A PARIS
[A] D'après un bas-relief ninivite du VIIe siècle av. J.-C., actuellement au British Museum. «Sardanapale» est ici pour «Assur-bani-pal».
[B] D'après un papyrus du Musée de Boulaq.
[C] Les fils et petits-fils du roi, dans l'ancienne Égypte, portaient une grosse tresse de leurs cheveux pendante sur la tempe, comme coiffure distinctive.
[D] Le Karma est un principe immatériel qui, pour les Bouddhistes, répond à l'idée de l'âme. Il ne conserve pas au delà de la tombe la personnalité de l'être humain; il en est la quintessence, ce qu'on pourrait appeler la résultante morale. Mais nous prenons ici le mot dans un sens plus précis, enveloppant sous ce terme la série impérissable d'effets dont toute existence devient le point de départ, et qui varie suivant chaque action, chaque parole et même chaque pensée de cette existence. Voilà en effet ce que nous laissons après nous d'immortel, ce qui attache au moindre de nos actes une telle importance et au rôle de l'homme une telle grandeur.—D. L.
[E] Vijayanagar, ancienne capitale du sud de l'Inde, dont les monuments sont encore debout, mais qui reste absolument abandonnée et dépeuplée.
| Volumes petit in-12 (format des Elzévirs) imprimés sur papier vélin teinté Chaque volume: 5 francs ou 6 francs Chaque œuvre est ornée d'un portrait gravé à l'eau-forte. |
|
|---|---|
| Victor de Laprade. Psyché. Odes. Harmodius. 1 vol. avec portrait | 6 fr. |
| —— Les Symphonies.—Idylles héroïques. 1 vol. | 6 fr. |
| —— Poèmes civiques.—Tribuns et courtisans. 1 v. | 6 fr. |
| —— Pernette.—Le livre d'un Père. 1 vol. | 6 fr. |
| —— Poèmes évangéliques. 1 vol. | 6 fr. |
| —— Les voix du Silence.—Livre des Adieux. 1 vol. | 6 fr. |
| Leconte de Lisle. Poèmes barbares. 1 vol. | 6 fr. |
| —— Poèmes antiques. 1 vol. avec portrait | 6 fr. |
| —— Poèmes tragiques. 1 vol. | 6 fr. |
| Le Livre des Sonnets, avec préface par Ch. Asselineau. 1 vol. avec frontispice. | 6 fr. |
| André Lemoyne. Poésies (1855-1870). Les Charmeuses.—Les Roses d'Antan. 1 volume avec portrait | 6 fr. |
| —— Poésies (1871-1883). Légendes des Bois et Chansons marines.—Paysages de Mer et Fleurs des Prés.—Soirs d'Hiver et de Printemps. 1 vol. | 6 fr. |
| —— Poésies (1884-1890). Fleurs et Ruines.—Oiseaux chanteurs. 1 vol. | 6 fr. |
| —— Prose: Une Idylle normande.—Le Moulin des Prés.—Alise d'Evran. 1 vol. | 6 fr. |
| Leopardi. Poésies et œuvres morales. Première traduction complète précédée d'un essai sur Leopardi, par F.-A. Aulard, 3 vol. avec portrait. Chaque vol. | 6 fr. |
| Daniel Lesueur. Poésies. Visions Divines.—Les Vrais Dieux.—Visions Antiques.—Sonnets Philosophiques.—Sursum Corda!—Souvenirs.—Paroles d'Amour. 1 vol. avec portrait | 6 fr. |
| Jules de la Madelène. Le Marquis des Saffras. 1 v. | 6 fr. |
Paris.—Imp. A. Lemerre, 25, rue des Grands-Augustins. 3.-2437